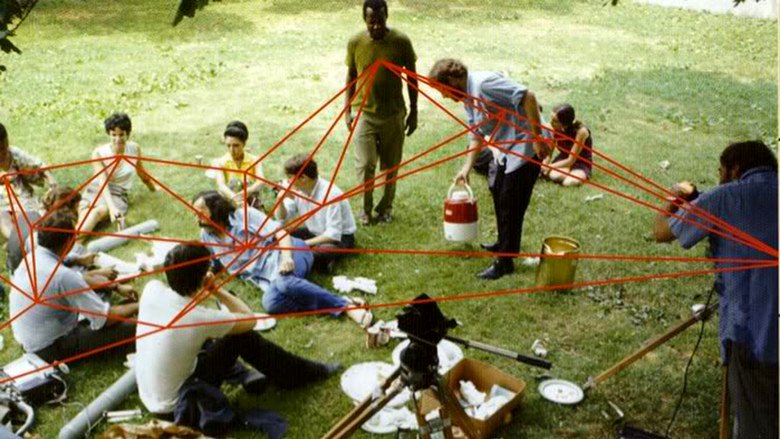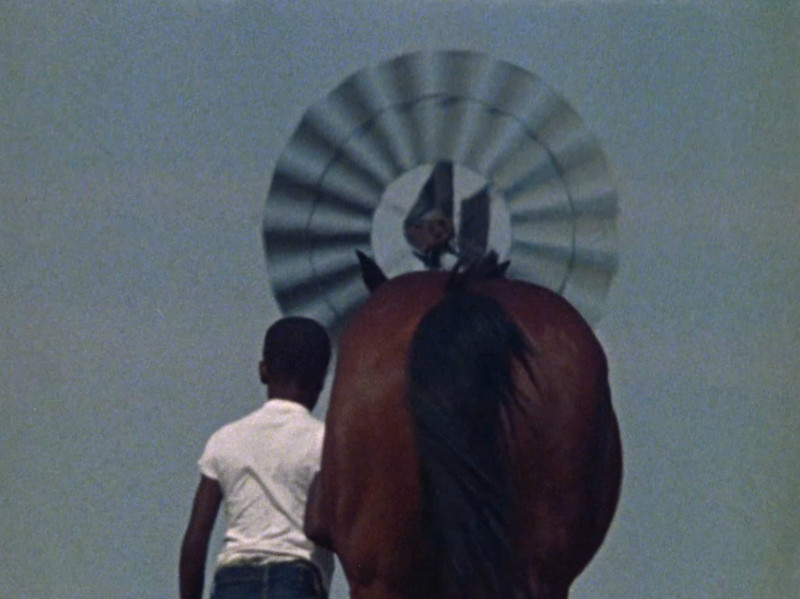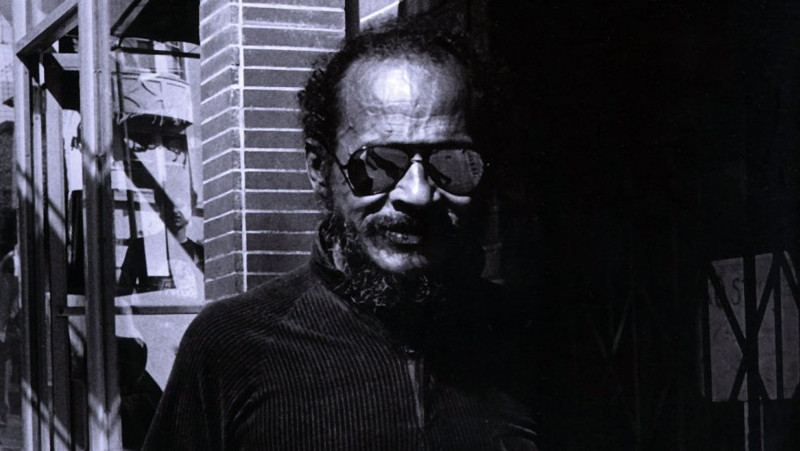INTERVENANT :
Lieu
L'Ancr'ier Voir sur la carteL’Europe a toujours beaucoup attendu du cinéma afro-américain, tant le système ségrégationniste et son racisme durable, nous paraissaient étrangers à notre propre comportement colonialiste, puis françafricain. Plusieurs facteurs expliquent cette fascination et même, cette espérance :
-il nous garantit un cinéma conscient, engagé, plein d’une énergie militante qui nous fait parfois défaut.
-il s’affirme comme un modèle de production alternatif à Hollywood mais aussi porteur d’une esthétique différente d’autres grandes écoles ou courants développés ailleurs sur le territoire américain (New York, Austin, Portland…), un mode de production communautaire et qui s’éloigne volontiers des canons mainstream pour récupérer les outils multi-médias nécessaires à un processus collectif.
-A l’instar de l’évolution et de l’importance de la musique noire dans la pop, le cinéma afro-américain est un jalon essentiel de cette culture populaire, jusque dans ses atours vintage qui suscitent aujourd’hui la nostalgie et continuent d’irriguer les nouvelles modes.
–Il est aussi le seul témoignage d’un melting pot se réalisant en dehors du système et de l’Amérique blanche mais aussi une interface avec des cultures ancestrales et des formes plus traditionnelles, quand le cinéma africain nous paraît en voie d’extinction ou au moins de plus en plus lointain de nos préoccupations culturelles.
Le bilan peut paraître modeste lorsqu’on observe ses différentes phases et périodes, si l’on se concentre uniquement sur quelques trois cents cinéastes afro-américains étalés sur plus d’un siècle et en laissant volontairement de côté les cinéastes blancs qui ont longtemps gardé la mainmise sur des films écrits et interprétés par des noirs. Avec le retour au premier plan de Spike Lee et la révélation de Jordan Peele, cette cinématographie se retrouve à la fois très étudiée et mieux diffusée ces dernières années (une remarquable anthologie dans les Cahiers du cinéma, la récente rétrospective au festival des 3 continents de Nantes).
Aux origines d’une contre-culture, la ségrégation
L’arbre du cinéma afro-américain a eu une croissance compliquée. Un premier âge assez riche qui va grosso modo de 1910 au début des années 50, soit l’ère des Race movies.
Mais à la base, des films plus sociologiques et anthropologiques furent aussi tournés, destinés à documenter les conditions de vie des noirs américains pour mieux promouvoir leur émancipation comme ce fut le cas pour mesdames CJ Walker (la première self-made millionnaire ! Une figure que Netflix s’empresse de promouvoir en 2020 dans Self-made) ou Toussaint Welcome, photographe personnelle du célèbre leader Booker T Washington. De ces origines, seuls subsistent quelques fragments tournés dans les années 20 en Floride par la première femme cinéaste noire américaine Zora Neale Hurston, bien plus connue comme écrivaine au sein de l’important courant de la Harlem renaissance. Dans la même veine anthropologique, l’épouse de l’activiste et comédien Paul Robeson et qui apparaîtra dans plusieurs productions à ses côtés, Eslanda Goode Robeson, tourne plusieurs films documentaires, aujourd’hui conservés, bien qu’invisibles du grand public.
Plus à notre portée naît un cinéma de fiction à partir de 1910 (The railroad porter, William D Foster en 1912), très inspiré par les poursuites des Keystones Kops et qui est contemporain de la création de la fameuse NAACP, association pour l’avancement des gens de couleur née en 1909. Dans le même registre comique, le comédien Bert Williams, pour qui Foster avait joué des vaudevilles, va tourner deux courts-métrages pour la Biograph en 1916 : Fish et A natural born gambler, mais qui, légère régression par rapport à la prise de conscience timide de Foster, perpétuent à des fins comiques les stéréotypes déjà à l’œuvre chez les blancs. Car en 1915, Griffith tourne son fameux Naissance d’une nation, dont le succès phénoménal comme les violentes réactions qu’il déclencha, fit pourtant office d’acte fondateur d’Hollywood aux yeux de l’Histoire officielle du Cinéma. Novateur cinématographiquement mais avant tout extrêmement raciste, la fresque historique popularise un grand nombre de clichés fixant pour longtemps la représentation des afro-américains à l’écran (l’alcool, la paresse, la lâcheté, le côté primitif, la lubricité…). La ségrégation scelle donc les fondements même de l’industrie cinématographique américaine, ce qui explique qu’elle y soit encore en pratique aujourd’hui.
Elle va paradoxalement booster la naissance de ce qu’on appellera les Race movies, autrement dit des films interprétés, écrits, parfois tournés ou produits par des noirs (mais là encore minoritairement puisque la catégorie offrait à de nombreux whiteys débutants, troisièmes couteaux ou cinéastes temporairement au chômage, l’opportunité de travailler pour des budgets exsangues et des moyens techniques rudimentaires, mais dans une relative indépendance (voir Ulmer notamment) et exclusivement pour un public noir. Le public afro-américain représentait en effet 10 % du public de l’époque et on allait lui proposer environ 500 films (environ une douzaine par an) diffusés dans les quelques 700 petites salles des ghettos jusqu’en 1952. On comprend donc la manne que cela représentait pour certains hommes d’affaires blancs (Léo Popkin ou Alfred Sack, qui lui confiera la mise en scène à des talents locaux comme Spencer Williams) qui n’hésiteront pas à collaborer pour donner à ce public ce qu’il est venu chercher : le miroir de sa vie quotidienne et l’expression de ses aspirations.
L’émergence de ce courant accompagne aussi les migrations de la population noire vers les grandes villes du Nord. Ce nouveau public urbain devient très friand de films compensant son déracinement et les compagnies fleurissent. C’est le début de la Lincoln motion picture company fondée à Omaha en 1916 par les frères Johnson et qui opérera à Los Angeles jusqu’en 1923, produisant et distribuant cinq films et à Chicago de l’Ebony film corporation, leadée par Luther J Pollard (mais contrôlée par des capitaux blancs) avec des films comme The mummy mumbled (1918), typique des Ebony comedies, moins stéréotypées que les précédentes. Citons encore la Million dollars production du natif Ralph Cooper dans les années 30, financée par les frères Popkin. Proche du leader Booker T Washington, journaliste, auteur, éditeur et représentant noir dans l’administration Wilson, Emmett Scott produisit en outre la réponse officielle à Griffith, The birth of the race (1918) dont la production dura deux ans à cause des scènes historiques calquées sur le modèle griffithien mais qui sorti après l’armistice et d’une durée de deux heures, fit un flop auprès du public. Enfin, Tressie Souders, tenue par certains historiens comme la première cinéaste noire officielle, écrivit et réalisa et produisit à Kansas city l’unique film (dit « réaliste » par son distributeur) A Woman’s Error (1922), alors qu’à l’époque où plusieurs personnes tournèrent des productions locales au Missouri, cette domestique de métier était membre d’une troupe de théâtre amateur. Elle déménagera ensuite à Los Angeles mais ne parviendra pas à se lancer dans le cinéma.
En 1919, un pur autodidacte, Oscar Micheaux, qui fit tous les métiers dont métayer, cireur de chaussures, ouvrier mais aussi romancier dès 1913 en créant sa propre maison d’éditions, tourne un premier moyen métrage The homesteader d’après l’une de ses propres nouvelles. Contacté par les Johnson qui souhaitaient l’adapter, il leur refuse les droits et déménage à Chicago pour y créer sa propre société de production. Il enchaîne avec deux de ses films les plus directement politiquement engagés, The symbol of the unconquered et Within our gates tous deux de 1920, deux nouvelles charges contre le film de Griffith avec une dénonciation virulente de la violence raciste des blancs, mais aussi un fort penchant mélodramatique qui n’a rien à envier à l’auteur d’A travers l’orage. Leur structure complexe allait de pair avec le large éventail des problèmes abordés. Entre autres et ailleurs dans son œuvre, le « passing », ou quand les noirs à la peau claire tentent de se faire passer pour blancs afin de progresser dans la société. Les femmes occupent également dans ses films une place de premier plan. Malgré ses œuvres « réalistes », il fut accusé à tort de réutiliser les stéréotypes des blancs. C’est qu’il n’entendait pas non plus minimiser les problèmes de la communauté noire comme le sexisme, mais conscient de l’importance de gagner un plus large public comme par goût personnel, s’en remettait également aux codes du genre (Films de gangsters, musicals…). Des capitaux blancs seront par la suite investis dans sa société, ce qui pour certains sera le début de sa « domestication », selon l’idée reçue et versifiée par la poétesse Audrey Lorde : « On ne démolira jamais la maison du maître avec les outils du maître». Il est plus probable que la rage s’émousse aussi avec le temps. Ses films sont en outre marqués par un langage très personnel, instinctif, mais qui fait aujourd’hui tout le prix d’une œuvre qu’on redécouvre petit à petit et dont la moitié de la quarantaine de films serait (encore) perdue. Sa totale indépendance en fait sans conteste le père du cinéma afro-américain actuel.
Dans une toute autre veine, le couple Eloyce et James Gist utilisaient de vraies personnes pour leurs films pédagogiques édifiants à destination du public des églises. Hellbound train (1930) s’attaquait aux péchés capitaux. Verdict : not guilty (1933) met en scène des visions infernales dignes de Mélies afin de condamner l’adultère et Heaven-Bound travellers (1935) est un drame familial rythmé par le combat du bien et du mal. Dans cette même veine, l‘halluciné The blood of Jesus (1941) a fait date, malgré un budget de 5000 dollars et des effets spirites assez délirants même si techniquement dignes du cinéma des premiers temps, quoique propres à frapper les paroissiens. Réalisé par l’ancien assistant Spencer Williams, ce réalisateur doué, fut d’abord comédien chez Bert Williams, puis scénariste (un western black et un des rares films d’horreur, sous genre qui reviendront régulièrement au-delà des années 70). Une polyvalence caractéristique de bien des comédiens noirs passant ensuite derrière la caméra. Spencer a aussi bien été gagman qu’ingénieur du son ou simple figurant. Il tournera au final une douzaine de films, essentiellement des fictions de long-métrage. Dirty Gertie from Harlem U.S.A. sera son autre titre de gloire en 1946, mais on peut voir Go down death ! (1944) ou The girl in room 20 (1946), un documentaire, quelques courts ou le film de propagande Marching on ! (1943) sur l’engagement de soldats noirs durant la seconde guerre mondiale. Enfin dès les années 40, un immigrant d’Australie à la peau sombre se fait un nom chez les afro-américains, William Forest Crouch avec Reet, petite and gone (1947) avec Louis Jordan, qui comme la majorité de tous les race movies, présente un grand nombre de numéros musicaux avec les meilleurs artistes de l’époque. La musicalité comme la place de la danse dans les œuvres perdureront dans la majorité de la cinématographie afro-américaine. Mais il ne faudrait pas pour autant oublier que les race movies comprenait aussi à la base toute œuvre issue des différentes minorités quelles quelles soient (indiens, asiatiques, juifs…) pour constituer un melting pop souterrain.
C’est l’intégration d’acteurs de couleur pour incarner des personnages acceptables par la majorité blanche (Harry Bellafonte, Dorothy Dandridge et plus tard la star Sidney Poitier) et la récupération par Hollywood de la thématique de la « question noire » qui est à l’origine de la mort des race movies et de la première disparition des cinéastes noirs.
Années 60 et 70 : vers le « Black is beautiful ! »
Le parcours de William Greaves, étudiant aux débuts de l’Actors studio, est en cela emblématique d’un refus de rentrer dans le moule imposé par l’Amérique WASP. Il lui faudra quitter le territoire dès 1953 et apprendre le métier avant de réaliser en 1959 son premier film au Canada au sein de l’Office National du Film (Emergency ward ou l’activité dans un service des urgences le dimanche soir). Mais rentré au pays au début du mouvement pour les droits civiques, il va être plébiscité par les Nations Unies et la United States Information Agency pour tourner dès 1964 le beau film introspectif et documentaire Wealth of a nation à une époque où seuls les cinéastes blancs (ou presque) tournent des œuvres engagées au côté du mouvement des droits civiques (Edouard de Laurot…). Dans la foulée il célèbre la culture afro-américaine au pays de Senghor dans The First World Festival of Negro Arts (1966). Il tourne ensuite la pièce maîtresse de sa carrière Symbiopsychotaxiplasm: Take One (1968), qui met en abyme le tournage lui-même et la figure du metteur en scène à travers la remise en question de son autorité et la réorganisation du collectif de tournage. Un film important de son époque et dont s’inspirera entre autres Norman Mailer pour sa satire Maidstone. Par la suite Greaves se penche sur l’histoire afro-américaine et livre plusieurs documentaires sur des grandes figures noires (Booker T Washington, Robeson…), entre documentaire didactique et plus classique et expérimentations à la première personne, recourant souvent au docu-fiction. En 2005 il ajoute un Take 2 1/2 à son classique tourné 37 ans plus tôt.
Toujours dans le champ documentaire, d’autres « surgeons » prouvent la survivance d’une production authentiquement noire. Le plus important est le moyen métrage du compositeur Edward Bland sur le jazz, The cry of Jazz (1959), ou des conversations entre intellectuels noirs et blancs sur les origines du jazz sont entrecoupées de vues documentaires des ghettos de Chicago ou de passages musicaux, notamment avec le Sun Ra Arkestra. Il a été considéré comme l’une des premières manifestations de la black pride en ce sens qu’il théorise le jazz comme l’expression même de l’âme de la communauté noire et qui prophétisait en outre les émeutes des années 60 à venir. On peut aussi le voir comme une importante source d’inspiration pour The connection de Shirley Clarke. Le film est en outre important par ses conditions de production. Il est totalement indépendant et n’a pu être réalisé qu’avec l’investissement de 60 bénévoles.
Formée aux côtés de Richard Leacock, Madeline Anderson réalise Integration report one (1959), film important sur la lutte de la fin des années 50 et l’aube du mouvement des droits civiques. À une époque où personne ne voyait l’intérêt du sujet, elle fut encouragée par Leacock et par le soutien financier de DA Pennebaker et de l’activiste, écrivaine et poétesse Maya Angelou qui interprète We shall overcome dans le film. Le film ne trouvant pas de distributeur, il sera d’abord projeté dans les églises et lycées en 1960. Il aurait du être être le premier chapitre d’une trilogie sur la constitution du mouvement, que personne ne crut bon de financer. Il reste le premier documentaire officiel à avoir été tournée par une afro-américaine. Elle ne sera reconnue qu’en 1970 avec le documentaire militant I am somebody, sur la lutte de 400 femmes employée par l’université de Charleston, bien que critiqué par le mouvement féministe du début des années 70. À noter son documentaire Malcom X : Nationalist or Humanist? (1967). Par la suite elle travaille à la télévision et continue d’être la voix de ceux qui n’en ont habituellement pas, comme les jeunes des quartiers de The Walls Came Tumbling Down (1975).
En 1967, des jeunes membres des gangs de Philadelphie prennent la parole pour réaliser un court film en super 8 entre documentaire et pamphlet, véritable appel à l’émeute. The jungle oppose la jungle urbaine des ghettos à celle dont on les dit originaires. C’est dans cette jungle que va repousser sur l’ancienne souche et un début de tronc de lutte commun le second arbre du cinéma afro-américain. Il faut aussi citer le beau court documentaire King is dead (1968) du photographe Jimmie Mannas tourné à la volée dans les rues le lendemain de l’assassinat du leader noir des droits civiques. Le premier coup d’envoi important est donné par Gordon Parks. Autodidacte, il avait été nommé photographe de l’année dès 1960. Il a opéré autant dans le social que dans le glamour ou le mondain et son humour acide était déjà présent dans des clichés devenus célèbres. Parks est aussi poète et compositeur. Il réalise à partir de 1964 plusieurs documentaires sur les quartiers noirs pour la télévision nationale dont un sur le poète new yorkais Piri Thomas (The World of Piri Thomas,1968). En pleine éclosion du cinéma indépendant, il est le premier à tourner à Hollywood son premier long en 1969, The learning tree (Les sentiers de la violence), une adaptation de son propre roman situé au Kansas dans les années 20.
Puis en 1970, c’est Ossie Davis qui réalise Cotton comes to Harlem, un polar d’après Chester Himes. Davis commence le théâtre dans les années 40 et devient un des acteurs noirs en vue dans la décade des années 60 notamment dans A man called Adam et Slaves. On peut voir le film comme l’ancêtre de la Blaxploitation, bien que préférant la comédie policière et parce que son duo de détectives blacks en fait surtout un néo-noir. Il contient une des premières évocations du mouvement Black power et surtout un tournage in situ à Harlem, sous le contrôle des Black citizens patrol car la criminalité y était assez forte à l’époque. Le même jour sortait sur les écrans la comédie raciale Watermelon man de Melvin van Peebles, elle aussi tournée à Hollywood, où un blanc raciste s’y réveillait noir, un thème tellement classique que par la suite, les autres comédies recyclant l’idée serviront de marqueurs pour constater la non-évolution des stéréotypes. Van Peebles revenait de France où il avait tourné La permission (1968) primé au festival de San Francisco et enregistré un premier disque, mais il tournait des courts depuis 1957, admirés par un français qui l’avait invité à Paris. C’est lui qui va réaliser l’année suivante le film le plus culte de la période, voire de tout le cinéma afro-américain, Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (1971). Tourné en mode guérilla et profitant de l’indépendance totale conférée par son ixage, le cinéaste y assurait aussi bien la musique que les cascades et les scènes de sexe. Le film est à la fois une œuvre délibérément choquante qui entend briser d’abord l’image de l’Oncle Tom et chasser le syndrome Sidney Poitier ou homme noir émasculé ainsi accepté par un monde de blancs. Le film dépasse plusieurs tabous : violence et révolte de Sweetback qui bât un flic blanc. Sexe interracial ou première scène d’amour avec la bikeuse blanche. Et contre l’image du nègre concupiscent immortalisée par Griffith, Melvin van Peebles impose au mâle noir viril un contrôle absolu (« Spermochoc » théorisé par le réalisateur). Bref d’un homme pourchassé par le système, on passe au « nègre dangereux » car puissant et brutal, le « Buck » admiré par Huey P.Newton. Enfin, c’est un grand film poème, la narration tenant du slam ou de l’incantation religieuse. Les effets visuels apparentent le film aux recherches psychédéliques de la période et les jump cuts abondent dans le montage lui apportant une dynamique très personnelle. Le film impose la musique comme élément moteur de la narration, et plus seulement comme soutien ou un contrepoint. Bien que classé X et sorti d’abord dans deux salles, le succès sera énorme et il rapportera 15 millions de dollars. Par la suite et après son adaptation du spectacle de Broadway Don’t play with Cheap en 1973, Van Peebles retourne à sa carrière d’acteur ou ne tourne plus que des œuvres très confidentielles. Mais le mythe est créé… De là, la nécessité selon Daney, d’intégration du refoulé pour renflouer le navire en proie à l’une de ses grandes grise décennales, le Nouvel Hollywood n’ayant pas encore rempli les caisses, ni fait germer le golden age des blockbusters.
Le second parrain et détonateur véritable de la vague qui va suivre est à nouveau Gordon Parks qui rencontre un immense succès à 59 ans en réalisant Shaft (1971) qui impose aussi Richard Roundtree en privé black et cool dans un univers urbain de néons typique de la décennie qui s’en vient. Le succès du film suffit à sauver la MGM de la faillite. Enfin, la musique d’Isaac Hayes et la longue montée de son morceau titre reste également un des plus grand succès de toutes les musiques de films. Shaft fixe quelques uns des codes de la vague dite de la Blaxploitation qui va suivre et dès le second opus l’année suivante Les nouveaux exploits de Shaft (1972), plus orienté vers l’action et dont on a voulut capitaliser sur la réputation et l’effet de nouveauté du premier. Prostitution, dope et action sont plus que jamais au menu du new yorkais The super Cops (1974) qui manque sans doute de comédiens charismatiques. Par la suite, Parks s’aventure dans le western black, sous-genre relancé dans l’euphorie du brassage et de la relecture des genres (Thomasine & Bushrod,1974).
Plus convaincant, le premier film de son fils Gordon Parks Jr, le mythique Super fly (1972), ses B Boys et son trafic de dope, mais surtout la BO inoubliable de Curtis Mayfield. Le dealer et le maquereau sont héroïsés, des bad boys sexués et violents qui incarnent un contre-pouvoir logique au système blanc. C’est aussi le règne des justiciers de tout poil, jusqu’aux femmes dangereuses qui rendront célèbre Pam Grier. Le « be cool, be black » est sur toutes les lèvres – et surtout dans tous les tiroirs caisses – de l’Amérique du début de la décennie comme s’en moque Ralph Bakshi dans Fritz the cat. La pléthore de films tournés jusqu’en 1979 offre à certains acteurs l’opportunité qu’ils n’auraient peut-être jamais eu autrement de passer derrière la caméra : Sidney Poitier d’abord, mais un très grand nombre parmi lesquels Ossie Davis, Fred Williamson (grand pourvoyeur de séries B d’action dont on détachera Mean Johnny Barrows en 1976, ou bien faire avec peu), Raymond St Jacques, Ron O’Neal pour Book of numbers (1973) situé dans les années 30 ou encore Ivan Dixon.
Célèbre acteur de séries ou du film culte Nothing but a man (1964) et président du Negro actors for action, après une grosse carrière à la télévision, Dixon tourne le crime movie Trouble man (1972) et surtout l’impertinent The Spook Who Sat by the Door (1973) d‘après le livre de Sam Greenlee paru en 1969. Le FBI le fera interdire car le prenant – avec quelques raisons ! – pour un appel à l’émeute. Moins politique mais plus frontal, la petite série B d’Oscar Williams, Emeute à los Angeles (The final comedown, 1972) met en scène l’affrontement d’un groupe nationaliste avec la police, cette fois avec moins d’ambition que chez Dixon. Prenant le contre-pied de l’exploitation, il tourne ensuite la comédie familiale (genre également très présent dans la décade quoique moins passé à la postérité!) Five on the black and side (1973), plus classique. Hot potato (1976) est par contre un kung-fu flick exclusivement situé en Asie et mettant en vedette la star du genre, Jim Kelly. Enfin Death drug (1978) dénonce la place de la drogue (PCP) dans le show biz. Un de ses comédien, D’Urville Martin, aux emblématiques moustaches, réalise pour la star culte du genre Rudy Ray Martin en maquereau, un Dolemite (1975) typique du genre gangster mais avec un personnage dont la tchatche allait assurer un franc succès au film et une postérité au comédien parmi les grands rapeurs de la génération suivante. Ossie Davis s’est lui d’abord éloigné du genre pour le drame familial Black girl (1972) qui dans la lignée de Madeline Anderson, s’intéressait aux femmes d’âge mur polétaires au temps du féminisme post black power. Il revenait ensuite à l’exploitation et à l’action en lorgnant vers la vetsploitation avec son film de vétéran en colère Gordon’s war (1973). Toujours du côté des arts martiaux, mentionnons le Melinda (1972) d’Hugh A Robertson, ancien monteur de Macadam cowboy et Shaft.
Nombreux furent aussi les transfuges du théâtre ou ceux qui menèrent les deux carrières de front, comme Gilbert Moses, produit et distribué par la Universal pour Willie Dynamite (1974), demeuré comme un des portraits de maquereaux les plus sexistes. En 1979 , il tourne The Fish That Saved Pittsburgh (1979) un film sur le basket, catégorie du film sportif la plus présente dans la black culture jusqu’à nos jours –mais déjà présente depuis les années 50 et les inoubliables Harlem globe trotters)...
Dans la plupart des films de la Blaxploitation et la longue liste de ceux réalisés par des blancs (dont d’excellents cinéastes comme Larry Cohen, Jack Hill, Jack Starett…), le noir est synonyme de coolitude, d’humour, de groove, de sensualité, de puissance sexuelle (voir par exemple The human tornado (1976) de Cliff Roquemore avec Rudy Ray Moore), de résistance et de rébellion violente. Clichés contre clichés… Le genre représente donc une des quintessences des aspirations de la société de l’époque après l’échec les mouvements protestataires, le Watergate et l’interminable fin de la guerre du Vietnam. Si sa vision le plus souvent machiste de la libération sexuelle s’est heurtée au féminisme émergent, sa liberté de mœurs a aussi choqué la société noire militante. Il est vrai que les héroïnes noires apparues après 1973, n’avaient pas le loisir de coucher pour leur plaisir avec des partenaires blancs, conscience politique des « Sisters » oblige ! Pourtant à l’intérieur de cette mouvance ultra codifiée, les cinéastes afro-américains ont parfois réussi à amener un peu de nuance (confronter le pimp de The mack à celui de Willie Dynamite…). Ont aussi émergé des discours divergents et des individualités non stéréotypées.
Fraichement émoulu de l’Actor’s studio, Christopher St John va transcender ses frustrations en s’écrivant, dirigeant et interprétant le curieux Top of the head (1972), sorte de comédie surréaliste où un policier noir tente d’échapper par les fantasmes aux dures réalités de son quotidien social. Noir jusqu’aux bout des ongles et complètement désabusé, ce sera son unique essai. Il s’attira les foudres d’Hollywood suite au tournage jusqu’à en être… blacklisté. À noter que son fils, star du feuilleton Les feux de l’amour, consacrera quarante ans plus tard un documentaire à ses parents, mais plutôt centré sur leur engagement au sein d’un groupe religieux mené par un drôle de gourou black indien.
Autre acteur venu du théâtre (compagnon de route de James Dean, il fréquentera Marlon Brando et Montgomery Clift), mais surtout auteur et à partir de 1968, scénariste, Bill Gunn est l’auteur de trois films dont seul un aura fait date, Ganja & Hess (1973). Le vampirisme y est l’arme secrète du Dr Hess pour réussir le « passing ». Le film s’inscrivait dans la veine horrifique du Blacula (1972) de William Crain, mais cette fois avec forces allusions politiques et volutes mystiques, époque oblige. Malheureusement son soap musical, Personnal problems (1980) réalisé pour la télévision n’y sera jamais diffusé, Gunn restant l’un des réalisateurs les plus étonnants de la décennie. De son côté, Crain, bien que diplômé de la UCLA, en prit le bord opposé. Après un film avec un curieux personnage interprété par Sidney Poitier (Brother John, 1971), il se faisait donc à jamais un nom dans cette veine sanglante avant de poursuivre avec une variation black d’un autre mythe, Dr Black et Mr Hyde (1976).
Plus parallèle qu’intégrée à la Blaxploitation, la comédie black s’est néanmoins développée au même moment, dès lors qu’une major s’est intéressée à Michael Schultz, encore un gars venu du théâtre universitaire puis de Broadway. D’abord avec la comédie raciale ancêtre de Jungle fever, Together for days (1972), puis la comédie d’action internationale Honey baby, Honey baby (1974), mais surtout dans une des premières comédie de campus rétro, genre alors en gestation, Cooley high (1975). L’énorme succès du film présenté comme un American graffitti noir aurait une profonde influence sur la génération suivante de cinéastes et dans un premier temps amenait Schultz à signer avec une major pour Car wash (1976, sur un script de Joel –plus blanc tu meurs !- Schumacher !). Le film aura en plus les honneurs de Cannes. Enfin, détail important, Richard Pryor y tenait déjà un petit rôle. Car Schultz allait devenir le metteur en scène attitré de la future star comique, imposant l’humour black dans la comédie mainstream pour plusieurs générations. Citons le Amazing grace (1974) où la thématique typiquement Blaxploitation de la corruption politicienne affleure ici sous le filtre de la comédie de quartier. Il est tourné par Stan Lathan, réalisateur qui s’en allait par la suite devenir un vieux routier de la télévision. Il signerait pourtant une œuvre importante de la Hip hop culture et du cinéma indépendant avec Beat street (1984) filmé in vivo dans les quartiers où fleurissent les premières battles de rue new-yorkaises et où l’on retrouve Grand Master Flash ou Afrika Bambaataa.
L’ascenseur social fonctionne bien sûr pour quelques grandes stars dont une Diana Ross en pleine gloire (et qui assure en outre le design de tous les costumes). C’est le patron de la Motown, Berry Gordy, qui éjecte l’anglais Tony Richardson pour assurer lui même la mise en scène bien lisse de cette comédie romantique et success story, Mahogany (1975).
De nombreux réalisateurs issus de la télévision et du documentaire purent parfois s’en échapper provisoirement comme Warrington Hudlin qui deviendrait un producteur important pour la communauté après avoir fondé en 1978 la Black Filmmakers Foundation.
Mais dans cette décennie 70, la seconde branche maîtresse du cinéma afro-américain héritière du mouvement pour les droits civiques mais plus aussi revêche, avait bourgeonné au sein de la UCLA dès 1969, ce que eux appelleront l’école des cinéastes noirs de Los Angeles et que le critique et historien afro-américain Clyde Taylor nommerait après la rétrospective de 1986, « L.A. Rebellion ». Plus indépendante, elle s’oppose au cinéma hollywoodien. Elle constate aussi avec raison que les recettes générées par la Blaxploitation ne profitent que très peu à la communauté afro-américaine. Ici vont incuber puis éclore plusieurs cinéastes aux préoccupations similaires – s’exprimer à tout prix par le film – avec des influences plus européennes ou autres qu’américaines (néo-réalisme mais aussi Cinema Novo et autres esthétiques tiers-mondistes) et entièrement dédiés à leurs communautés et à ses problèmes. Le premier acte significatif est celui de Thomas Penick avec son court-métrage 69 Pickup (1969), pourtant bien plus apparenté au cinéma guérilla et d’exploitation (deux hommes noirs y enlèvent une blanche pour la violer, une thématique qui influencera Brian de Palma pour son Hi mom ! l’année suivante). Ce mouvement est tributaire du contexte violent de l’époque (émeutes dans le ghetto de Watts, fusillade sur le campus avec le mouvement nationaliste noir Us de Ron Karenga, qui prônait l’autodétermination des noirs américains et dont les militants s’opposaient parfois violemment aux Black panthers (marxistes léninistes et maoïstes). Enfin, c’est aussi le début de la discrimination positive à l’Université qui permit à l’enseignant Elyseo Taylor, bientôt rejoint par l’historien du cinéma Teshome Gabriel, de promouvoir l’entrée de nouveaux étudiants noirs et l’émergence d’une nouvelle conscience cinéphile. Par ailleurs, l’opposition à la Blaxploitation telle que récupérée par l’industrie hollywoodienne allait cimenter leur travail, même si on y retrouvait le côté encore plus fauché (tournage en 16mm) et le goût pour la place de la musique noire. On y retrouvera différentes formes d’afro-centrisme, évidemment liées à un passé commun mais qui tendaient à faire de la négritude une expérience immersive, un principe cosmique qui comprenait évidemment la redécouverte des racines africaines. Ils allaient aussi intégrer les autres cinéastes issus des minorités (indiens, asiatiques, chicanos et latinos) ainsi que la reconnaissance progressive d’autres courants (féminisme, homosexuels) dans leur mouvement et ce dans une perspective politique (« Being in » plutôt que « Belong too »), militante (développement de formes alternatives de conscience) et même anthropologiquement beaucoup plus élaborée.
La plupart des premiers films des étudiants sont tournés vers l’idée de libération, ce qui les rapproche finalement de Melvin van Peebles, voire de certains Revenge movies de la Blaxploitation, même si le langage diffère comme dans le court Daydream therapy (1977) de Bernard Nicolas ou le Eva’s man (1976) de Anita W. Addison.
Charles Burnett est le premier grand auteur à émerger dès son court-métrage Several friends (1969), puis avec l’intimiste et presque classique The horse (1973). En 1977, son premier long et film de fin d’études, Killer of sheep, tourné en 16 mm à Watts pour un budget de misère et achevé au bout de cinq ans, va définitivement marquer le cinéma américain par la qualité de son regard et la mélancolie qui émane de cette peinture de la misère sociale. Burnett confirme son talent en 35mm et en couleur avec My brother’s wedding (1983) où un jeune du ghetto doit épouser une fille de la bourgeoisie noire. Nombreux seront les critiques blancs qui lui reprocheront cette évolution stylistique aboutissant à un budget de plus d’un million de dollars pour To sleep with anger (1990), tourné à South central. Cet échec commercial sera par contre couvert de lauriers. Puis The glass shield (1994) et Ice Cube lui amènent un meilleur accueil public pour cette histoire de corruption eu sein de la L.A.P.D. Burnett tourne par ailleurs un grand nombre de documentaires, dont le plus diffusé sera Devil’s fire (2003), produit par Martin Scorsese pour sa série sur le Blues.
L’évolution du cinéma de l’éthiopien Haile Gerima, lui aussi formé à la UCLA (Hour glass, 1971), sera similaire. Le cinéma guérilla assez Black power et un peu féministe, en noir et blanc et en quasi huis clos (Bush mama, 1976 sur les violences policières à Watts), puis le film néo-réaliste rural éthiopien, céderont plus tard à la fresque en couleurs sur l’esclavage (Sankofa, 1993). Entre les deux, Gerima tâte du docu militant (sur les Dix de Wilmington qui n’obtiendront justice qu’au bout de trente ans de prison !) lorgne vers la Vetsploitation (en plus militant qu’exploiteur) dans Ashes and embers (1982), magnifique chant du cygne des luttes radicales des années 70 et qui précède un retour vers son pays qui occupera par la suite la majeure partie de de sa carrière.
Un des cinéastes les plus importants du groupe et en même temps, l’un des moins identifiable depuis chez nous, est Larry Clark (et c’est sans doute du à l’époque contemporaine à la concurrence et l’ombre portée par son homonyme, star du cinéma indé). Ses films figurent pourtant parmi les plus engagés et les plus formellement intéressants. As above, so below (1973) est un nouveau récit de vétéran venu à la guérilla. Mais la guerre se fait aussi ici sur le plan esthétique, avec différents régimes d’images et autres ruptures de ton. De loin, l’œuvre la plus intéressante sur le sujet ! Mais son film le plus célèbre est Passing through (1977), un des films les plus importants jamais tourné sur la réappropriation du jazz par ses créateurs, le tout dans une mise en scène des plus free et avant-gardiste. Par ailleurs directeur photo génial, il ne reviendra qu’avec Cutting horse (2003), bien plus classique quoiqu’un des plus beaux westerns blacks jamais réalisés.
Ben Caldwell est aussi l’une des figures majeures de l’école. C’est lors de son incorporation au Vietnam qu’il en profite pour acheter une caméra et filmer les souffrances des G-I’s. Démobilisé il étudie d’abord la photo, puis le film et intègre la UCLA dont il sera diplômé en 1976. Pour Caldwell, il s’agit d’émanciper l’image même des noirs américains. Cela passe par la renaissance qui résulte de la redécouverte de ses racines comme la lente incubation intra utéro de Medea (1973) qui place la conscience culturelle au stade pré-natal et témoigne de l’intérêt que portait alors Caldwell aux différents formes de perception et aux univers parallèles. Très expérimentale, son œuvre est peu diffusée et on connaît tout autant ses collaborations (Barbara Mc Cullough) ou ses projets sociaux comme le centre communautaire Kaos network fondé au début des années 80 dans le berceau du jazz à L.A, Leimert park, et qui propose aux jeunes d’être en contact direct avec tous les nouveaux médiums et médias. L’influence de Caldwell reste cependant énorme.
Enfin, un des auteurs majeurs, quoique campant à l’autre extrémité du spectre créatif, est Jamaa Fanaka. Fasciné par Hollywood, il allait en effet être le seul du groupe à frayer avec la Blaxploitation. Welcome home brother Charles (1975) a ainsi été tourné du temps de la UCLA et raconte l’histoire d’un homme utilisant son pénis pour se venger de ceux qui l’ont emprisonné. Dans Penitentiary (1979), c’est dans la prison même qu’il doit utiliser cette fois ses poings pour survivre. Le film n’élude ni le contexte social, ni le message politique, tout en oeuvrant dans le cinéma d’exploitation, ce que confirmaient les deux suites tournées. Ces films honorables montrent qu’il faut nuancer les clivages par les œuvres qui les transgressent.
La seconde branche rebelle qui démarre véritablement à la fin des années 70, est son pendant féminin. La personnalité la plus marquante en sera sans conteste Julie Dash, qui après deux courts engagés autour des femmes signait le beau moyen métrage Illusions (1982) sur le racisme à Hollywood, puis le plus contemplatif Daughters of the dust (1991) dont le budget confortable lui assurait une visibilité optimale, tandis que sa puissance visuelle et son sens du récit lui garantissaient un succès dans les festivals internationaux. Elle ne s’y départit jamais de son sens de l’observation pour raconter l’histoire des Gullah, insulaires noirs vivant au marge de la Caroline du Sud. Un film authentiquement sudiste plus qu’académique. Ayant débutée plus tôt (Rain, 1978), Melvonna Ballenger appartient elle aussi à cette seconde vague plus féministe. Ainsi Nappy Headed Lady (1985) examine la position des femmes noires face aux standards de beauté véhiculés par et pour les blanches. Elle continue ce discours de réappropriation de sa propre image mais cette fois en direction des enfants et en animation dans Goldilock and the three bears (1991). Ce dernier film est produit par l’autre très importante figure féminine de L.A, Alile Sharon Larkin. On retrouve Charles Burnett à la caméra, les cinéastes de Los Angeles travaillant le plus souvent collectivement. En quatre courts (dont un doc) et un moyen métrage (le plus connu A different image, 1982), Larkin explore la question des origines et comment certaines en arrivent à les renier, que ce soit par la coiffure (The kitchen, 1975) – un thème récurrent à tout individu d’origine africaine et très répandu dans le cinéma des afro-américains-, le retour du refoulé dans Your children come back to you (1979) ou la volonté de se démarquer des canons pour imposer une image différente mais sienne.
Encore plus étiquetée féministe, Zeinabu Irene Davis a voyagé au Kenya, étudié les arts notamment africains avant de débarquer à la UCLA dans les années 80. Elle soutient, avec raison, l’émergence d’une esthétique propre aux films afro-américains. Un film comme Mother of the river (1995), drame au temps de l’esclavage tourné en noir et blanc, s’inscrit sans peine dans la filiation avec Charles Burnett ou Julie Dash, de même que A powerful thang (1991). Mais son travail n’est pas que fictionnel. Elle est très active sur le front expérimental par exemple avec Cycles (1989), un de ses films les plus primés et qui aborde les menstruations féminines. Très politique, Compensation (1999) traite d’une histoire d’amour entre une sourde et un entendant confrontés au racisme, utilisant des techniques du cinéma muet comme les intertitres ou l’insert de photographies afin de le rendre accessible aux deux publics en même temps. « Un petit film tranquille et enchanté » selon le critique indéboulonnable Roger Ebert. Ces dernières années, elle s’est consacrée au documentaire avec en 2015, Spirits of Rebellion: Black Film à UCLA, parfois très discuté par ceux-là mêmes qui y ont participé.
Barbara McCullough axe elle son travail sur la créativité et les rituels, parce qu’ils permettent de passer d’un espace et d’un temps à un autre. Ainsi, le sobre et visuellement rugueux Water Ritual #1: An Urban Rite of Purification (1979) s’inspire-t-il du spiritisme africain en usant des surimpressions. Tourné en vidéo, Shopping Bag Spirits and Freeway Fetishes: Reflections on Ritual Space (1981) interroge la démarche de plusieurs artistes engagés dans une série d’oeuvres improvisées. Elle y transgresse la frontière spectateur/ filmeur en s’y mettant elle-même à nu. Elle s’est intéressée à plusieurs artistes musicaux dont Horace Tapscott: Musical Griot (2017), un artiste qui a, au succès, préféré rester travailler avec sa communauté de Watts. «Stylistiquement, j’ai mon propre style. J’aime les choses décalées, inhabituelles. En même temps, j’aime que mes films reflètent la diversité de mon parcours en tant que Noire ainsi que les différentes influences qui m’affectent. Quand je fais quelque chose, j’essaie de montrer l’universalité de l’expérience des Noirs. Donc même si j’ai affaire à quelque chose de très décalé et de différent, il y a toujours une certaine ligne d’universalité qui traverse mon travail.»
Carroll Parrott Blue s’est plus particulièrement focalisée sur sur les femmes de la diaspora africaine ou le thème des arts visuels à travers ses documentaires (Smithsonian World (“Nigerian Arts-Kindred Spirits,”) 1996) ou des installations multi-média. Son film le plus connu est Conversations with Roy DeCarava (1983) sur le photographe qui a immortalisé la renaissance de Harlem. Parmi les autres cinéastes femmes de la L.A Rebellion, mentionnons Jacqueline Frazier, Imelda Sheen (Forbidden Joy, 1972), Alicia Dhanifu (Bellydancing : a history and an art, 1979) ou Omah Diegu issue de la diaspora nigériane. Originaire de San Francisco, Frazier vient de la littérature enfantine puis devient scénariste. En 1977, Frazier tourne dans le style de l’école en vogue Hidden memories, son film de fin d’études qui explore les différentes alternatives offertes aux filles-mères en une sorte de roman photo parfois nostalgique, parfois cruel et dans lequel la musique joue une grande place dans la bande son. Son court Azz Izz jazz (1978) immortalise un concert de cet ensemble et constitue donc un précieux document. Elle traite ensuite du racisme institutionnel au sein des écoles catholiques blanches avec Shepley street (1981). Enfin, le rôle de Shirikiana Ayna est majeur, moins en tant qu’épouse d’Haile Gerima que comme sa productrice et surtout comme distributrice du cinéma noir indépendant. Elle aura aussi tourné trois documentaires à partir de Brick by brick (1982) sur les questions du logement social et des relogements suite aux rénovations.
Dernière figure importante en queue de peloton, celle-là chez les hommes, Billy Woodberry. Après un premier court durant ses études, the Pocketbook, il tourne sur un scénario de Charles Burnett, Bless their little hearts (1984) qui sera primé à Berlin. On retrouve le noir et blanc de Killer of ship pour ce nouveau drame situé à Watts d’autant que Burnett est à la caméra. Centré sur le chômage de masse, il est surtout un peu plus désabusé. Il ne signera plus hélas qu’un documentaire consacré à une figure méconnue de la Beat generation, And when i die, i won’t stay dead (2015).
Bien des réalisatrices indépendantes se sont exprimées durant cette période en dehors de l’école de Los Angeles, même si on en perd la trace. La plus importante est la réalisatrice – mais aussi auteure de plusieurs pièces et scenarii – un peu maudite du New Jersey, Kathleen Collins, auteure du remarquable Losing ground (1982), premier film narratif de cette ampleur à avoir été réalisé par une afro-américaine et comme tel, acclamé dans les festivals étrangers mais pourtant resté inédit en salles dans son pays ainsi que du moyen métrage The cruz brothers and miss Malloy (1980). Celle qui préconisait de voir les humains avant d’y voir des noirs fait de Losing ground une charge féministe contre la bêtise masculine, qui prend ici le pas sur les différences sociales ou raciales. Las, la réalisatrice décède prématurément d’un cancer en 1988 à l’âge de 46 ans. Tout aussi météore fut la carrière de la cinéaste de Détroit Fronza Woods. Parmi ses quelques films connus, Killing time (1979) suit en neuf minutes le parcours d’une femme qui veut se suicider. Elle tournera ensuite le court documentaire Fannie’s Film (1982) cette fois dans les pas d’une femme de ménage dans une salle de sports. Venue de l’accompagnement d’enfants handicapés et des arts visuels (sculpture, céramique, puis photographie, lithographie et peinture), Camille Billops aura exposé dans le monde entier. C’est pourtant comme cinéaste que son nom restera dans l’histoire, dès son premier film (coréalisé avec son mari James Hatch) consacré à sa nièce toxicomane et à son chemin de croix pour décrocher de l’héroïne (Suzanne, Suzanne, 1982). Elle poursuivra cette veine autobiographique et documentaire dans Older women and love (1987) sur une de ses anciennes liaisons puis sur Finding Christa (1991) où elle tente de retrouver sa famille confiée à un orphelinat à l’âge de quatre ans. Elle réalisera trois autres films, même si l‘Histoire retient surtout le travail éditorial essentiel du couple sur la culture afro-américaine. Après 1969, Jackie Shearer réalise des vidéos pédagogiques institutionnelles à but social à Boston. Elle participe comme productrice à Thirld World, puis à Newsreel. Son premier film indépendant sera A minor altercation (1976) sur le racisme en milieu scolaire. Mais elle peine à exister en dehors de tout circuit traditionnel. «African American Independant Film. Who, what, where, when, why, how can we see them ? All very interesting and important questions whose answers will constitute my home. »
Toujours issue de Third world cinéma, structure fondée par Ossie Davis, puis passée par la télévision, Jessie Mapple tourne d’abord deux documentaires sur des thèmes sociaux et économiques durant les 70’s (Methadone: Wonder Drug or Evil Spirit, 1976 et Black Economic Power: Reality or Fantasy, 1977). Mais c’est avec Will (1982), tourné à Harlem pour 12000 dollars qu’elle devient une des premières cinéastes afro-américaines à diriger un long-métrage de fiction sur la désintoxication par la pratique du basket. Elle est ensuite la première femme noire à avoir pu réaliser deux films de fiction consécutifs avec Twice as Nice (1988), toujours situé dans le milieu du basket.
Fille de la poétesse révolutionnaire Sarah Webster Fabio, Cheryl Fabio œuvre dans le documentaire à Oakland depuis 1976 où justement elle réalise un film consacré à sa mère accompagnée par un groupe musical ( Rainbow Black: Poet Sarah W. Fabio, 1976). En 2017, elle signe pour la télévision Evolutionary Blues … West Oakland’s Music Legacy. Monica J Freeman tourne elle des documentaires à partir de 1975 quand Kathe Sandler alterne les genres à partir de 1982. On trouve également Michelle Parkinson ou Ayoka Chenzira, plus dynamique et qui depuis Philadelphie, a officié dans l’expérimental, le documentaire, l’animation en mélangeant joyeusement le tout. Cette activiste des médias bouscule les stéréotypes des afro-américains dans les médias mainstream. Ses premiers film de la fin des années 70 s’intéressent à la place de la danse. Puis dès 1984, elle entre au Sundance institute. Cette même année, elle tourne Hair Piece: A Film for Nappyheaded People, un court satirique mélangeant image réelle et animation autour de l’obsession pour la chevelure africaine-américaine. Le documentaire Secret Sounds Screaming: The Sexual Abuse of Children est son second film autoproduit. Alma’s rainbow (1993) est par contre une teen comédie située dans la middle class de Brooklyn. Après une quinzaine de films, elle s’intéresse désormais aux nouveaux médias, à l’interactivité et aux arts numériques. Enfin, la peintre et plasticienne Howardena Pindella dénoncé le racisme latent du milieu féministe durant les années 80 et réalise la vidéo-performance Free, white and Twenty one (1980) dans lequel elle parodie une femme blanche qui dialogue avec sa part noire, la traitant de paranoïaque.
Années 80 : entre narcissisme et rébellion, le temps de l’infiltration
Après ce foisonnement créatif, les années 80 sont marquées par le temps des individualités, qui elles sauront parfois trouver le chemin des studios et d’une reconnaissance artistique véritable auprès du public blanc comme d’Hollywood. Cette époque de transition est d’abord et avant tout celle qui aura vu apparaître Spike Lee.
Spike Lee est issu d’un milieu favorisé, ce dont témoigne la majeure partie de ses premiers films. Car c’est cette génération et cette classe sociale qui tambourinent à la porte de Hollywood. L’oeuvre de Spike Lee doit être aussi vue dans une plus large perspective d’évolution du cinéma indépendant dans le paysage new-yorkais et même, américain. Sa carrière est d’ailleurs fréquemment comparée à celle de son compagnon d’université, Jim Jarmusch. Lee a été comme lui repéré dès son premier film étudiant Joe’s Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads (1983). Il s’impose aux Etats-Unis et à l’international avec son film suivant Nola Darling n’en fait qu’à sa tête (1986), comédie indy et superbe portrait de fille libre tourné en noir et blanc et à la mise en scène éclatante. Le film est un grand succès commercial et remporte le prix de la Jeunesse à Cannes. Après un film de campus gorgé de P-Funk et de vannes extra-terrestres (School daze, 1988), peut-être un peu alourdi par des numéros musicaux pas tellement nécessaires, il réalise Do the right thing (1989), LE film emblématique de sa génération. La photographie très colorée, brûlante d’Ernest Dickerson et le Fight the power de Public enemy dictent le tempo au montage de Barry Alexander Brown. Une fresque emplie de colère, empreinte de mélancolie, mais qui incite aussi à la réflexion et à l’usage du libre arbitre. Aussitôt perçu par certains critiques blancs et conservateurs comme un appel à l’émeute, le cinéaste se verra dès lors très souvent associé à des polémiques et aux critiques des uns et des autres. Lui seront reprochés alternativement son racisme, son antisémitisme, son sexisme ou son irresponsabilité, Lee ne faisant guère d’efforts pour atténuer son discours dans les médias.
Il tourne ensuite le beau film sur le jazz Mo’Better blues (1990) en réponse au Bird de Clint Eastwood, choisissant un jazz plus branché, un milieu moins stéréotypé et surtout une époque plus contemporaine et moins représentée au cinéma. Encore une fois, il s’y réserve le rôle du personnage par lequel le drame arrive. Sa comédie bourgeoise Jungle fever (1991) apporte quelque amertume aux rares relations interraciales de l’époque. Il dépeint aussi les débuts du crack de la manière la plus crue (le “Sheraton du crack”) comme à travers le personnage joué par Samuel jackson (qui lui même sortait de son addiction à cette époque), ce qui lui vaut un prix d’interprétation à Cannes. La première – relative – deception dans la filmographie de Lee est due à la sagesse de son biopic de Malcom X (1992), qui marquera la fin de sa collaboration féconde avec Dickerson. Il y retrouvait Denzel Washington qui avait déjà interprété le leader musulman à Broadway. La production du film fut difficile. Le script traînait dans les tiroirs depuis les début des années 70 et comportait déjà un gros problème : l’articulation des vies privées et publiques de X. Remplaçant avec enthousiasme Norman jewison, Lee fut vite accusé par ses proches d’être un Buppie (un noir de la classe moyenne) bien éloigné du personnage dont il entendait faire l’hagiographie et on lui mit donc la pression. Du côté des producteurs, les dépassements de budget accélérèrent la fin de la post production et on l’obligea à ne pas dépasser les 2h15. Le tournage du film ayant lieu durant les négocations pour mettre un terme à l’Apartheid en Afrique du sud, Lee insiste sur la connexion afrocentriste dans le film.
Lee revient ensuite à un registre urbain et plus intimiste qui lui sied mieux, balançant entre chronique familiale (le très attachant Crooklyn, 1994) et faux polar mais vrai drame des années crack (Clockers, 1995). Ce projet, conçu par Scorsese mais abandonné au profit de Casino, fut hélas la premier échec commercial de Lee et on lui reprocha son abus des flashes back qu’il aimait tant ou la noirceur de la photographie. Il y inteprète Chucky commentateur de la vie de la cité avec son casque de chantier, allusion à Chuck D de Public enemy qu’au début du film, les jeunes revendeurs ne jugent plus assez hard. Chucky le bâtisseur, le metteur en scène, quand le récit est ici écrit par le flic blanc Rocco. L’Amérique, la ville, Brooklyn, la cité, comme un même organisme malade à l’image du ventre en bouille de son héros Strike, qu’on identifie au flic par ce même beeper, donc comme éléments clé d’un même système. Lee a ce talent unique, si profondément américain, pour dépeindre ses personnages humains ou tragiques, dérisoires ou grotesques, en quelques traits surs mais jamais caricaturaux. Si la narration insiste sur les différentes versions, c’est qu’aucun habitant ne saurait être coupable qu’à lui seul. Un moraliste mais avant tout et comme Chuck D, un chroniqueur politique. Chacun possède son tyran personnel et Rodney le parrain local, est interprété par le grand Delroy Lindo qui lui donne cette stature d’épouvantail. Tendresse et douleur mais réalisme social avant tout dans ce film emblématique du « Street cinema » de Lee. Le drôle de thriller érotique Girl 6 (1996) allait être pire et sonnait le début d’une période plus chaotique pour Lee qui prend alors l’habitude de se ressourcer au documentaire (Get on the bus, l’émouvant 4 little girls, 1997 pour HBO) avec des films plus militants, plus communautaires mais aussi assez classiques. Lee montre ensuite toute sa maîtrise avec He got game (1998), plein d’effets et d’émotions pour dire son admiration du basket, signant ici un des joyaux du genre, toujours avec Denzel Washington (lui aussi grand fan de ce sport) et Ray Allen, un débutant appelé à devenir l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Peut-être trop expérimental pour le grand public, le film sera un nouvel échec. Il revient donc à un style visuellement plus classique et s’offre un film vintage chez les italo-américains pour Summer of Sam (1999), fresque éblouissante injustement boudée par la presse et nouvel échec commercial. Il tâte ensuite du film de stand-up, genre typiquement afro-américain et revient avec l’ambitieux The very black show ( Bamboozled, 2000), dont le public apprécie peu la satire très engagée et l’aspect visuel (tournage en mini-dv), malgré un très beau casting (Jada Pinkett Smith, Damon Wayans, Mos Def…).
Retour au documentaire puis au lendemain des attentats du 11 septembre, un chef d’oeuvre classique sur un héros blanc joué par Edward Norton (La 25ème heure, 2002), avec enfin un succès à la clé. Puis c’est à nouveau un four avec She hate me (2004) dont le ton irrite à la fois la critique et le public américain, quand en France son ton décomplexé, sa vulgarité, voire son mauvais goût sont perçus comme réjouissants. Le cinéaste se replie à la télévision puis revient avec un solide thriller Inside man (2006) avec Denzel Washington pour un beau succès. Le travail avec Matthew Limbatique, chef opérateur noir et habituel collaborateur d’Aronofsky apporte beaucoup au cachet visuel du film et à son côté complexe. La même année il tourne un premier documentaire sur l’inondation en Louisiane et en rapporte un grand témoignage (Katrina, 2006). Ses films suivants sortent de moins en moins en France (Miracle à Santa Anna (2008) attendra plus de dix ans, Red hook summer (2012) dans sa série Chroniques de Brooklyn sera son plus gros échec commercial. Produit par et pour Amazon, Chi-raq (2015) transpose Aristophane chez les gangs de Chicago, provoquant à nouveau la controverse avec les institutions locales. Le film comporte quelques belles idées (Samuel L Jackson en choryphée ou sorte de Jiminy Cricket) et des scènes réjouissantes, même s’il braconne à la limite des plate-bandes du très ripoliné Tyler Perry et des films de Gospel. Parallèlement, Lee se tourne vers les remakes pour Oldboy (2013), très critiqué, et son Da sweet blood of Jesus (2014) financé par le crowfunding, nous refait Ganja and Hess avec un scénario coécrit avec Bill Gunn himself, sorti en VOD et en salles en même temps. Un documentaire hommage à son ami Michael Jackson pour prendre l’opinion à contrepied, suivi d‘une adaptation de She’s gotta have it (2017-2019) en série précèdent le retour inattendu du cinéaste au premier plan avec BlackKklansman (2018) produit par Jason Blum et Jordan Peele, d’abord pressenti pour le projet, qui devient son plus gros succès, reçoit un grand prix à Cannes et un oscar pour le scénario. Un film qui a pourtant du « sien » !
Par son gros désir de reconnaissance, Spike Lee aura imposé le cinéma afro-américain au premier plan. Il est le premier à cumuler evergure de la production, qualité artistique, message politique et succès commercial. S’il reconnaît la filiation avec Oscar Micheaux, il a comme lui officié dans tous les sous-genres de la Black culture, sans presque jamais perdre son style visuel flamboyant ou son goût des narrations complexes (flashes back et flashes forward) à la fois traumatiques et pulsionnelles, suscitant autant la fasciniation que la critique. On lui a reproché son trop grand goût pour le sexe et un langage châtié de même que l’on a souligné la qualité de ses bandes sons, son goût pour la couleur ou un travail formel léché. Il a su se remettre de ses échecs et faire du documentaire didactique une source d’apaisement, de ressourcement. Puis, passer par la télévision, Amazon ou les films de commande sans se renier. Ce rapport amour/haine avec son public, déjà affiché sur les poings de Radio Raheem dans Do the right thing, est la preuve de son impact réel et définitif sur toute l’histoire du cinéma comme de sa filiation avec les grands cinéastes classiques américains. Spike Lee a ouvert les afro-américains à la reconnaissance des institutions comme aux recettes du box-office en conquérant le public des classes privilégiées. Son combat militant a tout autant ouvert la voix à Obama comme il en annonçait déjà les limites.
L’autre auteur le plus marquant de la période aura hélas été un météore. Charles Lane signe le film muet et noir et blanc Sidewalk stories (1989) où comment évoquer en un conte sans parole la vie dans les rues de New York d’un artiste SDF qui recueille comme dans le Kid de Chaplin une petite fille devenue orpheline. L’exercice de style se tranforme en une chronique sans fards (mais pas sans style) de la misère de l’époque à Big apple. Mais le conte tourne court. Le film n’est pas distribué aux Etats-Unis bien que sélectionné à Cannes. Lane se retrouvera embauché par Disney pour une énième comédie raciale (Double identité, 1991) sans personnalité. Peut-être le plus grand gachis de tout le cinéma afro-américain.
La décennie est décidément le temps des auteurs singuliers mais solitaires. C’est le cas de Wendell B Harris connu pour un seul et unique film, qu’il réalise, écrit et interprète, puis quelques fugitives apparitions en tant qu’acteur et une série anthologique radiophonique. Mais voilà, son seul film Chameleon street, OVNI tourné en 1989 a quand même obtenu le grand prix à Sundance en 1990, ce qui le sauve de l’anonymat. Il y fait le portrait de l’artiste, escroc et homme chaméléon William Douglas Street Jr, en une version fictionnelle, black et canaille de l’autoportrait allénien de Zelig. La réalité n’est déjà pas triste, sa vie est même épique – sa dernière condamnation ne datant que de quelques années en arrière (2016). Le film a été vu autant comme une satire que comme une radiographie de la société américaine qui construit ou déconstruit les identités.
C’est aussi l’affirmation de la fierté homosexuelle noire, pour le moment côté garçons avec l’oeuvre pionnière de Marlon Riggs qui travaille à la fois sur la discrimination raciale et sexuelle. Etnic notions (1987) est pour une part un documentaire complet qui analyse les différentes catégories de nègres dans les représentations données dans l’histoire et la culture populaire. Mais il confronte la narration didactique à la musique et à la danse pour donner une forme originale. Puis son film catharsis, Tongues untied (1989), pratique le collage visuel et sonore pour traiter des différentes expérinces d’hommes afro-américains homosexuels, cette fois dans une forme personnelle : journal filmé à un moment où Riggs est déjà malade du sida, performance, poésie, chansons pour aboutir à un film radical et militant qui fut perçu comme une onde de choc mais aussi boycotté par les chaînes télé choquées par ce coming out audiovisuel et live. Sans doute ce que le cinéma queer nous a offert de plus beau depuis Un chant d’amour. Le court Affirmations (1990) reprend des prises non gardées du précédent montage et développe la notion d’homophobie quand Anthem (1991) ressemble plus à un tract d’agit prop gay sensuel et stylé, élégiaque et pourtant pas si éloigné de Spike Lee. Color adjustments (1992) reprend en long-métrage le travail de démontage des stéréotypes raciaux mais cette fois en se focalisant sur les programmes télé en prime time. Son film Black Is. . . Black Ain’t (1994) sera achevé sans lui après son décès à l’âge de 37 ans.
Autre forte individualité dans un domaine nettement plus décrié, la série Z. Pourtant il y a chez Chester Novell Turner quelque chose de délibéré, l’ombre d’un style qui transforme le cinéma amateur en vidéo, en quelque chose de sauvage et beau. Black devil doll from hell (1984) reste une expérience assez unique dans le domaine très formaté du cinéma érotique du début des années 80. Son dispositif ultra minimaliste (une femme découvre le plaisir après avoir acquis une poupée rasta soit-disant hantée), bien plus étrange que risible, favorise l’exploration de la psyché de la femme noire entre Blaxploitation et féminisme rebelle, à ras l’épiderme et dans une lenteur totalement mortifère. Il s’agit d’exorciser à l’africaine (la poupée fétiche), cette part de puritanisme liée au poids de la religion dans la communauté noire. Mais le sens du cinéma du réalisateur, son talent de songwriter et son électro anémique démontrent que ce n’est pas le hasard – le film a été tourné sur plusieurs années sans que la cohérence en soit affectée-, ni la simple magie du cinéma qui transforme cette chose en œuvre déviante, mais bel et bien un certain talent naturel, un regard. Une disposition à utiliser la vidéo pour ce qu’elle est, un outil d’observation sociologique. Moins choquant, son film à sketches suivant Tales from the quaded zone (1987) nous rejoue les films de SF fauchés ou de séries télé avec plus d’inspiration (toujours la gestion du timing, la cadre et particulièrement les gros plans). Il est tourné dans une indépendance totale, seules une centaine de copies VHS tourneront dans la région de Chicago. L’ambiance rappelle les premiers Jack Hill pour un résultat qu’aurait renié d’avance un Andy Milligan. Touchants dans leur mélancolie, les films de Turner doivent être rangés entre les dérives hallucinées d’un Jean jacques Rousseau atteint de minimalisme et les expérimentations provocantes de certains artistes vidéo.
Signe des temps, en ces années 80 ou bien des pop stars narcissiques passent elle-mêmes derrière la caméra (Prince), l’affaire est encore à la rigolade. D’abord avec Michael Schultz qui après avoir fait débuter Denzel Washinton (Carbon copy, 1981) dans la upper class WASP – un schéma qui reviendra dans Livin’ large en 1991 – va surtout dévoyer l’esprit de Beat street en un Krush groove (1986) avec les déjà stars Run DMC et les Fat boys (qu’il refera tourner dans Disorderlies en 1987), ce qui nous vaut quelques moments musicaux mémorables dans un ensemble très mainstream. En sus d’une king-fu comedy et d’un drame féminin très lacrymal, Schultz aura aussi mis le pied à l’étrier à Oz Scott et co-réalisé le Bustin’ loose (1981) de Richard Pryor.
Pour rester dans l’explosion hip hop du début des années 80, il faut citer la réponse west coast avec le documentaire de Topper Carew, Breakin’ n’ Enterin’ (1983) qui montre la vitalité de la scène californienne à la même époque. Hélas, Carew ne tournera plus qu’une comédie sexy assez salée et vite oubliée Talkin’ Dirty After Dark (1991).
Toujours dans cette génération yuppie-black, les frères Hudlin vont devenir des ténors du box-office, notamment avec la teen comédie semi-culte House party (1990) avec le duo Kid n’Play (et sa coupe de cheveux géante!). Après le College, Reginald rejoint son frère aîné Warrington dans le cinéma et ils tournent d’abord de nombreux clips. Adaptation de son court de fin d’études primé, House party est un énorme succès public (un des films les plus rentables de la décennie) et critique, au point de devenir une franchise (sans les Hudlin, sentant venir l’arnaque) dans laquelle les groupe de rap ou de R&B viendront se faire les dents. Les frères préfèrent enchaîner sur la romcom Boomerang (1992) avec Eddie Murphy (qui de son côté réalise en personne le rétro Les nuits de Harlem) et Chris Rock à ses débuts (qui passera lui aussi derrière la caméra dans les années 2000). Heureusement, ils mettent aussi en œuvre des projets là où on ne les attend pas, comme avec ce premier long métrage d’animation afro-américain Bebe’s kids (1992). Il s’agit d’une adaptation du stand-up culte de Robin Harris alors décédé et le film sera par la suite adapté en jeu vidéo. Puis La couleur de l’arnaque (1996) donne à Samuel L Jackson l’occasion d’emballer une satire du film de boxe assez réjouissante et The Ladie’s man (2000) met en scène Tim Meadows du Saturday night live dans le rôle du sexothérapeute Léon Phelps. Hélas, il se plante dans les grandes largeurs du passage au cinéma. Pendant une quinzaine d’années, Reginald Hudlin part au purgatoire de la comédie whitey ou pour le meilleur, de la production (Django unchained). Mais il reviendra à la réalisation à la faveur de la mode des films rétro réécrivant l’Histoire avec des héros de l’ombre noirs pour un Marshall (2017) plus au goût de la critique.
Autre auteur comique important, Robert Townsend, acteur de Chicago popularisé par ses apparition au Johnny Carson show (alors qu’Eddie Muphy l’avait brûlé au casting du Saturday night live quelques années plus tôt) et qui comme réalisateur débarque lui aussi du film de stand-up, genre qu’il cultivera tout au long de sa carrière, celui là pour la star… Eddie Murphy (Raw, 1987) ! La même année, il est révélé internationalement par son premier long véritable, la comédie Hollywood shuffle. Cette satire qui fait date s’inspire avec brio de tous les obstacles et stéréotypes que doivent affronter les comédiens noirs pour réussir. En 1991, il coécrit, toujours avec Keenen Ivory Wayans, interprète et réalise The five heartbeats, l’histoire sur trois décennies d’un groupe de soul de type Motown. Le film ne convainc pas, de même que le suivant, la comédie de super-héros The meteor man (1993) dont il est en plus coproducteur, avec entre autres Bill Cosby, James Earl Jones, Cypress hill… Il y interprétait un prof qui se transforme en super héros pour protéger sa banlieue de Washington DC où les gangs font régner la terreur. B.A.P.S. (1994) avec Halle Berry est un désastre et Townsend se replie vers la télévision. De cette période, on retiendra à la rigueur son biopic Little Richard (2000) et surtout sa version de Carmen (Carmen Hipopera, 2001) avec Beyoncé et Mos Def. En 2003, il tente un virage cinématographique raté avec le thriller Black listed. Puis en 2008 il offre le rôle du boxeur Sonny Liston à Ving Rhames dans Phantom punch (2009), parle d’éducation et de transmission dans le drame In the ive (2012), bien réalisé et de basket dans Playin’ for love (2015). Celui qui rêvait d’élever et de transformer le public noir par ses films réalisés en toute indépendance n’aura pas tenu ses promesses et s’en retourne à la télévision.
Le public lui a préféré les films de la famille Wayans. Sept des dix enfants de cette tribu de la banlieue New-yorkaise et élévée chez les témoins de Jehovah, sont devenus comédiens, scénaristes, producteur ou réalisateurs au cinéma ou à la télévision, sans oublier trois de leurs enfants. Leur premier tour de chauffe sera justement Hollywood shuffle qu’ils ont co-écrit, juste avant de commettre I’m gonna git you sucka ! (1988) parodie de film de vétéran, acerbe bien que timidement réalisée. La Fox va permettre à Keenen Ivory de développer durant quatre ans son propre show comique télé, In living colour, un Saturday night live black. Après une comédie d’action, c’est le début des Scary movie (2000) qui vont être le plus gros succès de tout le cinéma afro-américain rapportant 14 fois le budget de départ bien que la critique et l’avis des fans d’horreur soient des plus mitigés ! Le temps joue en leur faveur : ce qui paraissait d’une effroyable vulgarité au premier degré (toutes les blagues sexuelles) devient dans notre époque puritaine une délicieuse provocation, respectant à la fois l’esprit des slashers des années 80 et l’état d’esprit provocant et décomplexé du cinéma afro-américain. Un an plus tard, le second opus, qui contient des morceaux d’anthologie comme sa parodie de L’exorciste avec James Woods, est encore un assez gros succès avant que Abrahams et Zucker n’en reprennent les rennes, toujours chez Miramax, pour trois films supplémentaires. Deux de ses frères se transforment en agent du FBI puis en blondes pour FBI Fausses blondes infiltrées (2004) dont l’humour stupide et la vulgarité trouvent peu d’écho à l’époque parmi la critique. Le trio remet le couvert pour Little man avec le même succès et les mêmes détracteurs. D’aucuns reconnaissent qu’il existe un style et un esprit comique propre à la famille Wayans. Il est manifeste dans Dance movie (2009, Damien Dante Wayans). À la précision des parodies et hommages, se substitue un jeu cartoonesque qu’on a rarement vu si poussé sinon chez Jim Carrey et un burlesque dégénéré d’une force farrelyenne peu commune. Très bien réalisés, leurs films font par moments oublier tous leurs illustres prédecesseurs (Mel Brooks, les ZAZ), parvenant alors à élever l’idiotie au septième ciel. D’utilité publique, leur œuvre sera forcément (fatalement?) réévaluée.
Toujours à la même époque, des duos d’acteurs et réalisateurs se spécialisent dans le film d’action. Ce sera le cas d’Ivan Rogers, souvent associé au cinéaste Robert Brown. Rogers est un disciple de Williamson, tous deux étant natifs de l’Indiana et surtout un spécaliste en arts martiaux (Karaté, Kickboxing…). Two Wrongs Make A Right (Brown, 1987) est un film charnière entre la Blaxploitation des 70’s et les New jack movies des 90’s et un honnête polar. Rogers réalise lui-même l’ultraminimaliste et très bis Caged women II (1996), puis le revenge movie Forgive Me Father (2000). Carl Franklin fut lui aussi acteur durant plus de dix ans avant de retourner à l’école pour se former comme réalisateur et de tourner en 1989 le court Punk, plutôt indépendant et social. Sa rencontre avec Roger Corman et ses réalisations pour Concord vont précipiter sa carrière vers un tout autre genre de productions. Par ailleurs, la majorité de ses films ne seront pas afro-américains, ou très légèrement comme ceux avec Denzel Washington, le néo-noir Le diable en robe bleue (1995) dont il est aussi l’auteur du scénario qui fait un bide mais reçoit un bon accueil critique et le grand prix du festival de San Sebastian, Out of time (2004) qui impose dans un thriller très grand public le style fun et racé du metteur en scène ou encore le film de procès avec Morgan Freeman, Crimes et pouvoir (2002). Honorable mais un parcours qui laisse un goût de frustration.
L’histoire du cinéma afro-américain doit toujours être comprise dans un contexte politique local, mise en perspective avec une politique extérieure belliciste, un ultra libéralisme arrogant et cette éternelle ségrégation molle qui poisse, avec de fréquents coups de collier qui n’ont rien à envier aux lynchages des années 20. Deux administrations Reagan, un Bush senior et une guerre en Irak ont rendu pour le moins la situation sociale explosive. La montée de la culture hip hop, la réussite éclatante de Spike Lee, puis le succès commercial de la famille Wayans et enfin l’imagerie véhiculée par les très nombreux vidéo-clips encouragent l’arrivée d’une nouvelle vague.
Années 90 : De la vague gangsta dans les ghettos à la gentrification ou au Girl power
En 1991, seize cinéastes noirs sortent des films sur les écrans américains. 3 film s’en détachent et imposent une nouvelle tendance dans le genre des Crime movies, souvent rebaptisée en France films de gangs et vont rejouer comme dans le rap, le duel entre New York et la west coast.
À New York en cette année 1991, Mario van Peebles tourne New Jack City et Matty Rich, le moins connu mais très apprécié Straight outta Brooklyn. Fils de Melvin van Peebles, Mario a commencé comme acteur puis réalisateur de séries télé à partir du début des années 80. New Jack City est son premier film pour le cinéma. L’ascension de Nino Brown en parrain du crack par qui la vague va déferler à partir de 1986 intronise Wesley Snipes dans son premier rôle principal majeur face au flic anti-drogue interprété par Ice T. Ajoutons le jeune Chris Rock en indic. Le contexte social est juste, la méthodologie réaliste mais dans la tradition américaine libérale, la fresque – le scénariste Thomas Lee Wright était l’auteur d’un script pour Le parrain 3 – n’évite pas la fascination pour le truand donc un certain cynisme. Le film est efficace et sera le plus gros succès indépendant de 1991. Van Peebles ne confirmera pas les espoirs placés en lui échouant à devenir plus qu’un réalisateur de série content de ses effets quelque soit le genre : western black pour La revanche de Jesse Lee (Posse, 1993), film historique pour le trop sage Panther (1995), mais qui se regarde agréablement et a d’ailleurs été doublement primé à Locarno. Enfin, Gang in blue (1996) quitte le genre pour revenir vers les vigilante movies des 70’s. Puis BAADASSSSS! (2003) est un biopic en hommage à son père. Il revient au thriller avec Hard luck (2006) qui a le mérite de réunir à nouveau un trio issu de New jack City. Son film sur un bluesman en trournée, Redemption road, sera à nouveau un gros échec. Il travaille de plus en plus pour la télévision et ne revient qu’en 2018 avec Armed, sur un shérif victime d’hallucinations après avoir été exposé aux produits chimiques durant le Vietnam. On peut considérer Mario van Peebles comme un héritier légitime de Walter Hill et comme ce dernier, il reste un artisan chevronné qui peut au moins se targuer de trente ans de carrière en milieu hostile.
Classé par certains comme tout film de gang de la côte est dans les New Jack movies, le film de Matty Rich, a été écrit à 17 ans et interprété et réalisé en totale autoproduction à l’âge de 18 ans. Malgré un manque de moyens flagrant et la modestie de la mise en scène (assez télévisuelle), Straight outta Brooklyn a raflé la mise à Sundance. Les gunfights y sont remplacés par les palabres. Plus tard, l’échec de son teen movie 70’s, The inkwell (1994), a sonné le glas de sa carrière. Plus marquant, le passage à la réalisation de l’ancien chef opérateur de Spike Lee, Ernest Dickerson. Situé à Harlem, Juice (1992) offre le rôle du bad guy à Tupac Shakur, l’idole du rap west coast conscient (Queen Latifah ou Dr Dre y font des apparitions) et est vraiment considéré comme un des sommets du genre par la critique américaine. Il faut dire que Dickerson est un excellent technicien doublé à l’occasion d’un styliste, même lorsqu’il alterne avec des projets plus commerciaux (Que la chasse commence avec Ice T (1994), le feel good buddy movie A l’épreuve des balles,1996) ou rate des projets plus ambitieux comme Blind faith (1997). Son buddy-movie anti-raciste. Mais s’il ne marche pas outre Atlantique, Embuscade (1998) préfère confronter son flic noir à un gamin de 12 ans endoctriné au Ku Klux Klan plutôt que de sacrifier à l’imagerie habituelle, avec un résultat étonnamment sobre. Une belle série B. Il tire assez bien son épingle du jeu (le dystopique Future sport ou le new jack stylisé à l’extrême Never die) de son passage au petit écran mais il faut quand même avouer que par la suite, seule se dégage la réjouissante comédie horrifique Bones (2002). La perle du genre revient à l’acteur Vondie Curtis-Hall bien qu’il lorgne outrageusement vers la comédie déglinguée avec Gridlock ‘d (1997) avec à nouveau Tupac, accompagné cette fois de Tim Roth pour un buddy movie enlevé et aux dialogues salés. Une satire de la vie à Detroit et de son administration très autobiographique et devenue culte. Par la suite, seul son thriller Waist deep (2006), un Bonnie and Clyde black échappe quelque peu à l’anonymat.
Même si plutôt rattachés aux plus anciens crime movies, les films new-yorkais de Bill Duke ont une importance notable. Acteur largement identifié (Predator), Duke commence comme beaucoup à réaliser à la télévision puis signe les trois drames criminels A Rage in Harlem (1991), Deep Cover (1992), Hoodlum (1997), puis Cover (2008), dont seuls les deux premiers méritent d’être retenus. Le premier pour la truculence de son adaptation de Chester Himes, le second pour son atmosphère. Pour le reste, il faut bien avouer que la mise en scène y demeure bien trop lisse, et ce jusqu’au très conventionnel Dark girls (2011), un documentaire qui avait la bonne idée de traiter des rapports de couleur à l’intérieur même de la communauté afro-américaine. Enfin, il y a bien un gang et quelques histoire de drogue dans le très classique drame Jason’s lyric (1994) par le collaborateur de George Jackson et producteur de New Jack city, Dough McHenry.
En queue de peloton, on ne peut oublier l’essai unique du clippeur Hype Williams, Belly (1998) où les racailles sont devenus les nouveaux riches. Décors ultra sophisitiqués, contrastes et couleurs violentes pour un film avec le duo Nas et DNX qui ne passe pas inaperçu. Certes le style prend cette fois-ci nettement le pas sur le fond social. Il ne pourra réussir à monter d’autre projet. Ne reste donc que cette bizarrerie clinquante.
Il y a toujours le mauvais garçon de service… Fils d’un couple de junkies porto-ricains et noirs et né dans le Bronx, Joseph B Vasquez commence à tourner ses propres films à l’âge de 12 ans et sort diplomé en cinéma de l’école de New York en 1983 à l’âge de 21 ans. Il tournera son premier long en 1989, The Bronx war, une série B fauchée et sèche qui sortira début 1991 avec la vague des New Jack movies. Ce film de gangs est d’abord un film indépendant, tourné dans son quartier au moment de la pire période sociale et criminelle que traversait alors le sud du Bronx. Vasquez réussit un film atmosphérique et réaliste qui tire le meilleur parti du paysage urbain et d’une absence totale de budget. Il y interprète aussi le premier rôle, celui d’un Cosmo Vitelli local et revendeur de crack, quand le casting entièrement amateur se donne corps et âme au film. Il tourne ensuite pour New line Hangin’ with the Homeboys (1991), un drame de l’adolescence avec entre autres John Leguizamo devenu célèbre après le Cocaïne de Paul Morrissey, sur quatre jeunes portoricains en virée à Manhattan et qui sera présenté à Sundance et considéré comme l’un des meilleurs films de la période. Street hitz (1992) est ensuite un film de frères, à nouveau situé chez les gangs du sud du Bronx et toujours tourné en autoproduction. Maniaco dépressif, Vasquez traverse une période sombre aux limites de la folie et s’embarque dans un film de danse sur des latinos rêvant de triompher à Broadway, Manhattan merengue. Il meurt la même année du SIDA à l’âge de 33 ans. Mais certains new yorkais lui vouent encore un culte féroce car il a su montrer leurs vies et leur ville comme personne.
Sans trop savoir où la classer, il faut mentionner le coupe de maître de DeMane Davis dont le premier gangsta film indépendant, Black & white & red all over (1997), constitue l’acmée d’une recherche esthétique dans ce sous-genre un peu ingrat. Elle donnera en 2001 Lift, un film de casse avec Kerry Washington situé à Boston, puis disparaît vers la télé.
La seconde catégorie a l’avantage d’être plus large puisque la Hoodsploitation ne traite pas que des problématiques de gangs californiens, mais comme son nom l’indique, de la vie dans les ghettos de Los Angeles. Le coup d’envoi en est donné en 1991 par l’événement Boyz’n the hood réalisé par le très doué John Singleton, alors âgé de 22 ans et tourné à South central. Boyz ‘n the hood fixe les archétypes du genre en même temps qu’il prend le pouls d’un quartier à la veille de l’affaire Rodney King et connaît un énorme succès. Poetic justice (1993) avec Janet Jackson, Tupac et une apparition des Last poets, est un bel hommage à la poésie afro-américaine sur des vers de Maya Angelou qui connaît lui aussi le succès, devenant même en dépit d’une mise en scène plus sage, une sorte de film culte grâce à son duo principal. Idem pour Fièvre à Columbus university (Higher learnings, 1995), avec des prix pour l’interprétation de Lawrence Fishburne, Ice cube, Omar Epps… Il traite des tensions raciales au sein de l’Université à une époque où les fusillades n’étaient encore pas si fréquentes aux Etats-Unis. L’accueil de Rosewood (1997) sur le massacre en Floride de 1923 fut plus mitigé, certains accusant Singleton d’être peu réaliste quant aux conditions sociales de la population de l’époque qu’il ne parvient pas à appréhender. Ils est néanmoins un chaînon important sur la voie d’une réppropriation de leur histoire par la commaunuté noire. Le cinéaste sera remis en selle financièrement par le remake de Shaft avec Samuel L jackson. Puis, retardé par l’assassinat de Tupac, Baby boy (2001) est un coming of age sis dans le milieu des gangs, avec notamment Ving Rhames et Snoop Dogg et qui ne brosse pas les jeunes mâles dans le sens du poil. En 2014 et après pas mal de déboires personnelles et judiciaires, Singleton a accusé ouvertement les studios d’empêcher les réalisateurs noirs de s’exprimer sur des thèmes qui les intéressent. De fait, lui n’a plus pu diriger autre chose qu’une grosse machine décérébrée ou un film de petits blancs jusqu’à son décès prématuré à l’âge de 51 ans.
La fratrie Hughes a laissé espérer une relève. D’abord avec le classique gangsta Menace to society (1993) dont l’intrigue se situe à Watts, plus noir, plus violent, moins engagé et plus complaisant que le film de Singleton, d’où une sévère et violente brouille avec Tupac et un accueil dithyrambique de la critique blanche, assorti d’un énorme carton en salles. Dead president (1995) impose le style des jumeaux cette fois dans une histoire de vétéran de la fin des années 60 et sur fond de rébellion politique. Plus flamboyant qu’historique mais indéniablement fascinant ! En 1999, leur documentaire American pimp rend hommage au monde de la prostitution et aux maquereaux en particulier. Puis c’est le succès d’un film bien blanc en apparence, From hell (2001) puis du post apo gris clair Le livre d’Eli (2010). Par la suite leur carrière se scinde et piétine (Alpha, 2018 par Albert). On en retient juste The defiant ones (2017), mini série documentaire de Allen Hughes sur la contribution de Dr Dre et Jimmy Lovine à la musique populaire américaine.
Né dans une famille de théâtreux, Robert Patton-Spruill tourne son premier long Squeeze (1997) en totale indépendance avec des jeunes comédiens issu du théâtre amateur. Un portrait juste de jeunes ados coincés à Boston entre gangs et dealers et de très loin, une des perles du genre ! Malgré ce succès, Body count (1998) sera pourtant un direct to video avec John Leguizamo. Le film lui assurera néanmoins une réputation. Il préfère monter sa propre compagnie avec sa femme et s’orienter vers la vidéo indépendante, le court-métrage et les très petits budgets durant dix ans. Le gangsta rap est à l’honneur dans Turntable (2005) au style de plus en plus influencé par les clips qu’il tourne. Ce qui le conduit à travailler avec Public Enemy et à tourner pour eux le succès international Welcome to the terror dome (2007), point d’orgue de sa carrière.
À Philadelphie, Abdul Malik tourne avec son complice Jay-Z le new jack State property (2002), sa seule incursion hors du clip. Tim Story commence par deux films du genre mettant en vedette l’inquiétant Kevin Mambo (One of us tripped en 1997 et The firing squad en 1999) encore très loin de ses succès commerciaux futurs.
Se développe aussi à cette époque une veine action plus commerciale. Un des plus illustres représentants en sera F Gary Gray, pourtant venu au long-métrage avec Friday (1995) petit film branché pour Ice Cube (dont il a commencé à tourner les clips dès 1992, tournant aussi pour Dr Dre, Queen Latifah ou Cypress hill notamment). La « feel ghoodsploitation », avec esthétique de sitcom, photo colorée mais aussi pour le meilleur, tchatche et affétéries indées. Friday conserve le thème du deal, tout en essayant comme le voulaient les scénaristes Ice Cube et DJ Pooh de montrer les aspects positifs du quartier plutôt que sa violence. Son ton comique en fera un énorme succès et même un film culte, succès que Cube capitalisera dans deux suites dont il sera également le producteur avec sa société Cube vision. L’année suivante Gary Gray triomphe avec Le prix à payer (1996), un film de casse (ou heistfilm aux Etas-Unis, sous-genre plus dramatique souvent marqué par les faiblesses des personnages de gangsters qui les conduisent à l’échec et qui par ailleurs insiste plus sur les relations entre les personnages que sur le casse proprement dit) où on retrouve Queen Latifah et Jada Pinckett Smith. Négociateur (1998), malgré Samuel L Jackson ou Que justice soit faite (2009) avec Jamie Foxx sont des thrillers bien blancs, toujours solidement réalisés mais qui manquent un poil de caractère pour faire la différence. Gary Gray va alors devenir l’actionner préféré des Diesel, Travolta ou Statham avec gros casting et rentabilité à l’avenant (Braquage à l’italienne). On est donc surpris de le retrouver là où on ne l’attendait plus, soit aux commandes du film hommage aux N.W.A, souhaité par Cube et Dre comme une autocélébration. Juste dosage polissé entre Hoodsploitation et biopic rap (largement contesté par les fans), Straight outta Compton (2015) se regarde néanmoins tout à fait plaisamment. Bien que peu reconnu, son bilan s’avère supérieur à celui d’un Antoine Fuqua, dont seul Piégé (2000) avec Jamie Foxx et Training day (2001) avec Denzel Washington méritent qu’on s’y attarde. Le style ne remplace pas l’état d’esprit…
Après la romcom friquée avec Halle Berry, Strictly business (1991), le comédien Kevin Hooks tourne Liens d’acier (Fled, 1996) un cyberthriller avec un Laurence Fishburne barbu qui semble avoir emprunté plus de la moitié de ses plans, soit au Fugitif, soit aux Evadés, avant de mettre en vedette Patrick Swayze puis de se tourner vers la télévision pour devenir une cheville ouvrière de la série Prison break.
Tourt comme le scénariste de Fled, Preston A Whitmore 2, qui semblait suivre le filon avec son film de vétérans Walking dead (1995), avant de donner lui aussi dans le film sportif Crossover (2006) qui flirte avec les voyoux du Streetball et la comédie romantique (This Christmas, 2007), avant de revenir aux mauvais garçons de Philly dans True to the game (2017)
Désormais établie, la veine Blackhorror continue de diffuser son poison, surtout avec le film à sketches de Rusty Cundieff. Comédien pour Spike Lee dans School daze, il avait déjà largué son humour acerbe dans le mockumentary vulgaire et irrévérencieux Fear of a Black Hat (1993) avant de signer Tales from the hood (1995). Une bande qui opère plus qu’une simple variation de couleur sur les Contes de la crypte : des topiques sociaux et politiques réinvestissent le genre et en font bien mieux qu’un simple teen movie, un petit brûlot horrifique.
Neema Barnette a eu deux carrières. Celle à la télévision l’a rendue célèbre puisqu’elle fut la première afro-américaine à diriger une sitcom, avant d’être la première à avoir eu deux contrats comme réalisatrice. Mais en 1998, elle réalise le film de fantômes Spirit lost, baignant dans le surnaturel et le passionnel qui constitue un essai intéressant. Puis elle prend les armes et incarne la révolte féminine dans le WIP Civil brand (2002) qui fleure bon les bandes les plus engagées des années 70, en en inversant les stéréotypes de genre. Hélas, elle n’incarne plus aujoud’hui que les craintes de la classe moyenne. Au départ associé à la LA Rebellion pour son court Rich (1983), S Torriano Berry ne tournera qu’un seul long-métrage qui anticipe en 1996 la vague des légendes urbaines (Embalmer). Enfin, un autres comédien de School daze, James Bond III, a fait produire le très honorable Succube (1990) par la firme Troma, relevant même sensiblement le niveau de leurs productions lambdas. Finalement, son plus gros défaut est de n’être qu’un one shot.
Nettement moins drôle, le problématique Sean Weathers qui entretient le culte d’un cinéma de guérilla, à la fois comme nécessité vitale et limite instinctive, fut révélé en 1996 par le film de zombie domestique totalement fauché House of the damned réalisé à l’âge de 16 ans. Il révélait déjà l’implication physique étonnante de ses comédiens. Son second long-métrage, They all must die (1998), s’abreuve à la veine salace. C’est le retour du sexe masculin comme arme de guerre dans un conflit racial poussé à l’extrême et au degré le plus élevé de violence sexiste, en réhabilitant une esthétique de snuff hyperréaliste (mais assez peu crédible, qu’on se rassure, si ce n’est que là encore la motivation des comédiens aurait plus à voir avec le porno ou les roughies d’un Costello). Puis, Lust for vengeance suit le parcours d’un serial rapist et de cinq de ses victimes, usant d’effets nettement plus stylés de filtres colorés. Weathers ne s’assagit pas avec le temps. Le réalisme et la brutalité habituelle des scènes sexuelles de Maniac too (2013) est alterné avec des prises de vue urbaines nocturnes. Des ambiances glauques dignes des vigilantes des années 70. Enfin, dans Scumbag hustler (2014), son antihéros s’avère tout aussi vicieux que désespérément toxicomane. L’interprétation grotesque en fait un sommet d’hilarité totalement déconnecté du sujet. À partir de 2006, Weathers est devenu son acteur principal, puis après 2015, son propre cameraman, ce qui l’oblige, d’une part à penser où poser sa caméra dès lors qu’il est en action et de l’autre, à abuser des plans subjectifs et des jeux de mains ! Il tourne beaucoup, vite et de plus en plus mal, le sordide ayant cédé la place au grand guignol façon Uncut première période. Arrivé à la quarantaine, Weathers est définitivement le black le plus noir et surtout le plus irrécupérable. Pour le vérifier, tous ses films sont en VOD sur Viméo !
Notons que surfant sur les vagues – ou à leurs franges, quelques cinéastes ont officié en leur temps dans le thriller érotique : Capuccino (1998), puis Motives (2004) de Craig Ross Jr ou le Trois (2000) de son producteur Rob Hardy.
Le cinéma afro-américain a donc connu une augmentation quantitative du nombre de productions et de cinéastes, même s’il végète dans des sous genres historiques. Pour le pire, dans son « école académique » qui voulant s’ériger en réaction face à la récupération bienveillante d’un Spielberg (La couleur pourpre, Amistad), prise de conscience sérieuse qui n’oublie jamais le rôle à jouer du cinéma, à la fois l’aspect très concrètement pédagogique de son langage comme ses fonctions historiques et sociologiques. Mais se réapproprier son Histoire passe aussi par l’expérience, donc par la nécessité de l’erreur. D’où un besoin croissant de substituer un regard noir à l’entreprise de déculpabilisation des blancs, sans éviter dans la plupart des cas la naïveté de l’approche et de marcher sans en avoir les moyens dans les bottes du cinéma hollywoodien de tradition classique.
Hors le film de famille et le biopic musical, George Tillman Jr nous gratifie de l’édifiant Les chemins de la dignité (2000) avec une histoire de plongeur noir qui n’a pas peur de frôler le fond. Rétro mais plus intéressant, Lackawanna blues (2005) tourné pour HBO par George C Wolfe, fait le portrait d’un quartier new yorkais et suit son évolution. Toujours du côté télévisuel, Debbie Allen améliore son côté policé (Polly) pour un plus ambitieux Stompin at the Savoy (1992).
Au même moment, le film sportif connaît un petit âge d’or: Hurricane season (Tim Story, 2010) s’impose, entre autres grâce à Forest Whitaker dans le rôle de Al Collins, un entraîneur de basket de la Nouvelle Orléans qui tente de faire oublier les ravages de Katrina. Ce coup de gueule contre l’injustice sociale arrivait juste après Coach Carter (Thomas Carter, 2005), ses clichés et la discipline de fer façon SL Jackson. N’oublions pas le beau et romantique Love and basketball (2000) de Gina Prince-Bythewood produit par Spike Lee en personne. All you ve got (2006) de Neema Barnette choisit de traiter de façon ultra classique un sport qui l’est moins sur grand écran, en tout cas aux Etats-Unis, le volley ball féminin. Heureusement, c’est du côté de la jeunesse qu’on parvient le mieux à saisir l’énergie qui se dégage des terrains comme le prouve brillamment le court-métrage réalisé à l’Université par un fils d’immigrants nigérians de la middle-class, Rick Famuyiwa (Black top lingo, 1996) qui a le grand mérite de réussir à filmer le basket pour ce qu’il est, un engagement, donc du contact humain.
Pris à Sundance, Famuyiwa va d’ailleurs persévérer et donner de bons films dans la veine indépendante comme The wood (1999), un feel good movie produit par MTV qui entend inverser les stéréotypes et présenter la vie dorée, à Inglewood, une banlieue de Los Angeles loin des ghettos. Brown sugar (2002) traite de la Hip hop culture avec entre autres Dr Dre. Son plus grand succès et son meilleur film, le coming of age Dope (2015), qui apporte un peu de légèreté dans la veine cool et décontractée. Autre tentative mais moins couronnée de succès, celle de Robert Wheaton (issu de la franchise House party) avec At the bus stop (1991), un récit sous forme de quatre vignettes, toutes situées à un arrêt de bus.
La veine hip hop n’est évidemment pas tarie, tant les rapeurs prennent plaisir à s’exprimer à l’écran, plus qu’aucune autre pop star avant eux. Dj Pooh réalise donc The wash (2000), un quasi remake de Car wash avec Dr Dre, Snoop Dogg et Eminem, avant de gagner pas mal d’argent avec la screwball comedy 3 strikes (2001), éreintée par la critique. Quant à Paris Barclay, lui aussi plutôt connu pour ses activités télévisuelles, il a réalisé Spoof movie (ou Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood, 1996), soit la meilleure parodie de la famille Wayans qui s’en prend ici et au dernier degré, à toute la Hoodsploitation.
La comédie d’action cartonne avec Eddie Murphy (Le flic de San Francisco, 1997, Thomas Carter) pour un comédien star habitué aux réalisateurs 100 % blancs). Mais elle va se faire de plus en plus mainstream au fur et à mesure que son public élève son niveau de vie, voire s’embourgeoise, avec Malcom Lee (The best man, 1999), Lionel C Martin (Def Jam’s how…1997), Christopher Scott Cherot (le très racaille The male groupie en 2004 ou le arty façon soderbergh sur le casting d’un comédien dans le court Andre Royo’s big scene), Martin Lawrence ou Kevin Rodney Sullivan (Sans complexe, 1998). Notons enfin la franchise sur la vie d’un salon de coiffure de Chicago, Barbershop (Tim Story, 2002), qui fait partie des meilleurs succès d’Ice Cube. Ce glissemnt commercial n’est pourtant pas encore comparable aux deux décennies suivantes…
Mais après les films de gang, le phénomène le plus important de la décennie 90, c’est bien la forte et constante croissance du nombre de réalisatrices africaines américaines. Elles prennent place dans les genres classiques comme Kasi Lemmons (encore une sortie de School daze !). Son premier long avec Samuel L Jackson, Le secret du bayou (1997) où une jeune adolescente de Louisiane découvre les infidélités de son père, se taille un beau succès et fait bien mieux que beaucoup de films académiques du même tonneau dramatique. Hélas, elle se prend un bide avec le même Jackson en schizophrène avec The caveman’s valentine (2001). Elle rebondit avec le film d’époque Talk to me (2007) sur le DJ et militant des droits civiques, Ralph « Petey » Greene, puis l’adaptation du musical de Broadway Black nativity (2013) qui fait un four malgré son gros casting et enfin un nouveau film historique au temps de l’esclavage avec Harriet (2019), un portrait de femme trop académique. Aux antipodes, une fille va mettre un peu de peps et de sensualité dans la Hoodspolitation, c’est Darnell Martin, une métisse dont le film I like it like that (1994) va faire un carton à l’international, sans rien perdre de sa verve ni de son style indépendant. Auparavant, elle s’était faite repérer par son court-métrage Suspect (1991) qui pointait la discrimination policière envers les jeunes noirs des quartiers populaires. Malheureusement, la décennie suivante, elle se range et en vient fatalement au classicisme historique avec Their Eyes Were Watching God (2005) sur Eatonville, puis au biopic musical avec Cadillac records (2008) avec Adrian Brody, Mos def et Beyoncé. Enfin le plus gros espoir, Leslie Harris, a déçu. Celle qui avait mis Miramax à genoux en en négociant elle-même les conditions de sa distribution dans plus de 200 salles américaines, avait réalisé Just Another Girl on the I.R.T. (1992), le plus beau portrait de fille rebelle de la période avec la formidable Ariyan Johnson, un film comique et péchu écrit, réalisé et produit en toute indépendance. Pour punition, elle restera ensuite à la porte d’Hollywood sans pouvoir y financer un second long.
Car dans la plupart des cas, les réalisatrices ont bien du mal à confirmer. Que ce soit au plan de la confiance des studios et des producteurs comme à celui de la gestion de la vie privée, il est encore difficile d’être réalisatrice, noire et femme en Amérique. Les exemples abondent : Millicent Shelton avait débuté chez Spike Lee aux costumes (Do the right thing). Après une dizaine de clips, elle réalise en 1998 le très important Ride, une Hip hop road movie comedie, puis disparait dans les séries télé. Alison Swan, née à Bermuda, se fait connaître avec son second film Mixing Nia (1998), une comédie sur la recherche identitaire d’une femme dans un environnement métissé. Après son mariage avec un producteur, on ne lui connaît plus qu’un scénario et quelques apparitions à l’écran. Et puis il y a Carol Mayes, trois courts-métrages et un téléfilm, dont l’intime et social Rituals (1998) laissait pourtant augurer un vrai tempérament.
Celles qui persistent optent pour une voie plus expérimentale, mais aussi un chemin moins visible. Cauleen Smith est sans conteste la grande figure de ce courant. Passée par la UCLA après avoir réalisé des courts depuis le début des années 90 (dont le beau collage audiovisuel sur le thème des origines Chronicles of a lying spirit by Kelly Gabron en 1995), elle y réalise en deuxième année et à rebours du protocole de l’école, un vrai long-métrage, le très beau Drylongso (1998) qui traite des vicissitudes de la condition féminine africaine américaine et de l’émancipation d’une jeune fille par la photographie, lui permettant d’exorciser la violence machiste. Marchant dans les traces de la L.A Rebellion, elle devient une cinéaste et artiste influente pour la vague actuelle. Elle travaille par la suite à Chicago où elle effectue plusieurs résidences et installations multi-médias. À cette époque, elle commence à travailler sur l’héritage de Sun Ra. À partir de là, elle travaille la culture black à la lumière du féminisme, de la spiritualité et de l’Afrofuturisme. Vues très récemment à Rotterdam, ses projections s’accompagnaient toujours de performances.
Le cinéma féministe évolue logiquement vers un courant lesbien militant. À Philadelphie, Cheryl Dunye commence après ses études à réaliser des courts mélangeant réel et fiction s’intéressant aux femmes noires et aux problématiques homosexuelles. Dans The Watermelon woman (1996), elle affirme encore plus cette ligne et transcende largement les races. Tourné pour HBO, Stranger inside (2000) examine ces thématiques dans le milieu carcéral pour un résultat cette fois plus conventionnel, de même que ses films suivants (la sorte de Trois hommes et un couffin, My baby’s daddy (2004) enfin en plus musclé !). Elle réalise encore quatre courts-métrages assez divers avant de se consacrer à la télévision. Fille d’un officier de police de Chicago, Yvonne Welbon va elle travailler à partir du documentaire dès Monique (1992), puis fonde le projet Sisters in life (qui aboutira en 2003 à un Sisters in cinema et tourne son film le plus connu Living with Pride: Ruth C. Ellis @ 100 (1999). Elle a aussi été une personne charnière en tant que productrice de Zeinabu Irene Davis ou Cheryl Dunye.
Toutes ces cinéastes remettent en cause l’héritage de la Blaxploitation comme dans le Naked acts (1996), une comédie acide de Bridgett M Davis où la fille d’une icône des 70’s refuse de retirer ses vêtements à la demande expresse d’un réalisateur. Troy Beyer, psychologue et écrivaine, réalise en 1998 Let’s talk about sex qui prend la fausse allure des documentaires sur la sexualité pour jeter un regard cru et ironique sur sa génération. Hélas, elle se tourne bien vite vers la romance avec Love don’t cost a thing (2000) et Ex free (2015). Éternelle aliénation du mariage…
Le cinéma afro-américain des années 2000 : assèchement ou foisonnement ?
Parvenu à ce stade, le cinéma afro-américain est maintenant l’un de ces grands flamboyants. Sur les frondaisons, partout des talents bourgeonnent, se ramifient. Des chiffres faramineux émergent durant les années Obama (165 longs-métrages afro-américains réalisés entre 2009 et 2016 mais on ne sait si cela comprend ou non le documentaire, les direct to dvd…). Cependant, et déjà depuis les années 90, trop souvent le même schéma de « domestication » se répète. Un jeune cinéaste se fait repérer par un court-métrage (Steven Kapple Jr avec A different tree) et se retrouve à étudier à Sundance, puis réalise dans la foulée un long-métrage « indépendant » (liste inombrable!). A la suite de quoi, soit il continue au cinéma, soit choisit la télévision dont il aura le plus grand mal à s’extraire. Le long-métrage suivant est très souvent un film en costumes ou situé en milieu rural, dans le sud profond notamment. L’étape suivante : ayant prouvé son aptitude à gérer une grosse production, on le confine dans les sous-genres habituels dévolus aux blacks (films de danse, comédie, film sportif, biopic de rapeurs) ou on lui confie la réalisation d’un thriller avec des comédiens blancs en vue. Plus récemment Netflix s’est imposé comme la nouvelle usine à gaz à digérer les jeunes talents (Nzingha Stewart…).Voilà comment le système américain se régénère dans 80 % des cas, mais dans ce processus d’assimilation aux valeurs de l’establishment se dissout toute vélléité d’auteur, même si certains arrivent encore à faire preuve d’une certaine classe sous le vernis classique (Charles Stone III, Kevin Willmott…).
La comédie est devenue le genre le plus consensuel et policé, à en faire bailler dans sa tombe le Arnold de Willy. Le parcours de Chris Rock en tant que réalisateur le montre bien. Pour tout classique qu’il soit, Président par accident (2003) n’était pas dénué de charme – un Obama case à la Capra, mais il allait très vite tomber dans la romance insipide ou branchée avec Je crois que j’aime ma femme (2007), puis Top five (2014).
Est-ce un hasard si le seul essai à peu près convaincant est signé par un artiste reconnu qui passe à la réalisation… à 47 ans ? Sorry to bother you (2018) est à notre époque l’une des rares tentatives d’analyser les mutations de la société américaine à l’heure des mensonges du télétravail, comme de la place des noirs américains dans ce modèle capitaliste unique. On peut épiloguer sur le retour à la réalité de son anti-héros mais la mise en scène du rappeur Boots Riley (The coup) tient la route et par ailleurs le film vaut pour son ambiance de quartier à Oakland. « Les acteurs de la politique radicale qui s’attachent à une esthétique, un slogan ou autre, sont à côté de la plaque. Tant que la vraie situation matérielle ne change pas, cette esthétique ne sert à rien. » Espérons que Boots Riley ne perde pas sa lucidité dans les projets avec les ogres HBO et Netflix.
Mais hélas, le plus souvent, les événements n’en sont pas. Justin Simien ne parvient jamais à emballer le thème satirique de Dear white people (2014) sur la mode afro-américaine. Pire, le cinéaste encensé à Sundance paraît n’avoir que ça à dire. Après la comédie romantique Peeples (2013), Tina Gordon casse la baraque avec Little (2019) où une chefe d’entrepise détestable se voit renvoyée à son adolescence difficile. Malgré une réalisation colorée où reignent les pastels et l’abattage de l’enfant-star Marsai Martin (plus jeune productrice d’Hollywood à 14 ans !), on ne nous épargne aucun cliché de la google comedy et on est loin de la simplicité enfantine de Big. Erik White nous refait Le million avecLottery ticket (2010) puis tombe à Atlanta dans son propre piège (The trap, 2019, un peu éreintant). Venu de la radio, Russ Parr commet la comédie romantique Love for sale (2008) avant d’enfoncer le clou en une version de groupe très représentative de son époque, 35 and ticking (2011).
Le parangon du cinéma américain est-il devenu l’infâme Tyler Perry? Traumatisé enfant par différents abus, il doit aux bienfaits conjugués de l’écriture et de la foi d’avoir changé (thème de son premier spectacle chrétien basé sur le pardon). On lui attribue à l’époque 300 spectacles par an et 35000 spectateurs, auxquels se rajoutaient la vente des spectacles en vidéo et le merchandising. À partir de ce pécule et assuré de son réseau, il peut autofinancer son premier film pour le cinéma Madea grand-mère justicière (Darren Grant, 2005) où il interprète trois rôles dont celui de cette grand-mère fouettarde qui remettrait n’importe quel américain dans le droit chemin. Au delà de quelques ficelles burlesques, le mélo romantique et le moralisme chrétien plombent un ensemble qui allait devenir un terrifiant succès de l’Amérique pré-Trump. Perry allait ensuite exploiter le filon en un certain nombre de suites utilisant le show télé d’Oprah Winfrey, véritable outil de contrôle des masses. Tel Satan, Perry ne se repose jamais : Daddy’s little girls (2007) avec Idriss Elba est d’un conservatisme effarant, Pourquoi je me suis marié ? (2007), achevant de nous convaincre d’une réincarnation des Gist et de Spencer Williams dans un corps de sitcom lancé avec tous les moyens de l’arsenal médiatique. Sans compter qu’il ne craint pas d’afficher ses origines théâtrales, bien au contraire… Perry en gomme le discours trop directement chrétien pour élargir son audience, mais le public un tant soit peu évolué n’est pas dupe. Pourtant aux Etats-Unis, les critiques s’émoussent et Hollywood se pâme devant son succès. Perry commence à faire l’acteur chez les autres (Abrams, Fincher). Il est impressionnant de constater à quel point il crache son venin sur tous les problèmes sociaux des afro-américains, ripolinant tous les sous-genres ou archétypes (sport, showbiz, musique…) et débauchant les stars (Mary J Blige) les unes après les autres. Visionner son œuvre est pour un athée non américain un long calvaire, pour un cinéphile la négation du cinéma. Tyler Perry ou comment confondre la solution et le symptome !
Dans son sillage, tous paraissent ramer et se noyer dans le sirupeux : Qasim Basir dans le contexte électoral de A boy. A girl. A dream (2018). Christine Swanson dans le diptyque All about you (2001) et All about us (2007), dont le héros prône de « good black movies » avec de « good contents ». Une drôle de parabole sur les valeurs du nouveau cinéma afro-américain ou comment recycler de vieilles valeurs. Rashad Ernesto Green habille sa romance du look sundance et teenager pour Premature (2009), quand Gina Prince-Bythewood essaie de cultiver l’amour sans tomber dans la niaiserie avec Beyond the lights (2014), en opposant aux stéréotypes de Perry (le brave flic, l’artiste corrompue par le système) des sentiments et des personnages un peu plus fouillés. Seul Terence Nance, après le plus classique How do you feel ? (2010) tente de concilier art et amour avec un minimum de créativité qui évoque les héritages de Gondry et Linklater dans une profusion d’idées et de formes (An oversimplification of her beauty, 2012). Peu intéressé par la dramaturgie, il préfère depuis expérimenter exclusivement sur des formes courtes.
Les biopics continuent de se suivre et de se ressembler. A la télévision c’est le Withney Houston : destin brisé (2015) d’Angela Bassett et au cinéma, Crazy sexy cool : the TLC story (Charles Stone III, 2013) sur le légendaire groupe de R&B des années 90 qui récupère au passage tous les tics des films de boys band. Ecrit par Tina Gordon, Drumline (2002) suit le parcours d’un jeune batteur de rue de Harlem devenu leader du célèbre marching band Southwest Dekalb High School Drumline de l’université d’Atlanta et est à la fois classique et différent de par le dynamisme de son montage on ne peut plus volontariste. Charles Stone III offre aussi un rôle à une Zoe Saldana en début de carrière.
Les biopics de rappeurs s’enchaînent : NWA, Tupac, Notorious B .I.G (2009) par le producteur de Barbershop, George Tillman Jr qui remplit parfaitement le cahier des charges sans trop se compromettre non plus, le film étant produit par la mère du rappeur. Enfin Morgan Cooper, s’est fait un nom depuis Kansas city par un simple trailer qui réinventait la série qui a imposé Will Smith dans les années 90, Le prince de Bel-air. En quatre minutes postées sur You tube, il a su développer dans Bel-air (2019) une attente mondiale pour une relecture contemporaine de cette série icônique sur l’ascension sociale et très autobiographique quant au parcours de Smith.
La veine hip hop ne s’est pas tarie mais elle aussi domestiquée. Après avoir assagi et presque dévitalisé le kung-fu flick (L’homme aux poings d’acier 2012), RZA, bien moins inspiré comme cinéaste que comme compositeur, a tiré le portrait d’une jeune rappeuse dans le très consensuel Love beats rhymes (2017) qui ferait passer le rap pour un concours d’éloquence. Pour retrouver l’esprit hip hop, mieux vaut suivre le sillage du photographe de Harlem, Khalik Allah dans son documentaire Popa wu a 5 % story (2010) ou le jeune docu Hell up in east Harlem sur l’East side.
Le film de danse est en berne. On ne parlera pas de l’énorme lot de films insipides destinés à engranger les dollars du public adolescent, mais force est de constater que le Step sisters (2018) de Charles Stone III produit pour Netflix, assez nul cinématographiquement, est plus proche de Save the last dance que de School daze.
Côté sportif, le basket demeure numéo un avec dans sa version familiale le Uncle Drew (2018) de Charles Stone III où un vieux scarabée met la pâtée à de jeunes rapaces dans cette revanche des maisons de retraite, ou le Note to self (2012) de Trey Haley, qui allie basket et jeux amoureux. Le plus ambitieux est avec son superbe noir et blanc, Jayhawkers (2013) le biopic des Jayhawks de Kansas city de 1919 à 1956 à travers le combat de leur coach Phog Allen, lorsque celui-ci en vient à recruter Wilt Chamberlain, qui après l’université du Kansas et avant son entrée à la NBA, fut membre des Harlem globe trotters. Ce scénario donne l’opportunité à Kevin Willmott, toujours passionné d’Histoire, d’explorer les racines du mouvement des droits civiques mis en parallèle avec l’évolution de l’équipe. Enfin, son approche cinématographique intéresse plus dans un sous-genre où on attend toujours la relève du He got game de Spike Lee, dont les deux affrontements père-fils restent toujours les plus beaus morceaux de basket portés à l’écran. Le plus réflexif, envisageant le basket en tant que mouvement et expression corporelle est la la courte vidéo de Dana Washingtondans Ode to AND1 Basketball Notes on the Sporting Black Body (2020), autant match commenté en ligne qu’objet filmique contemporain, mais qui a plus de choses à dire que la majorité des films sur le sujet en nous invitant à y lire les corps noirs différemment.
Comme toujours, la boxe se classe en seconde position. Deux poids lourds pour la période, les deux Creed (L’héritage de Rocky Balboa, 2015 par Ryan Coogler et Creed 2 de Steven Capple Jr en 2018) qui se contentent d’assurer le job sans trop chercher le KO du spectateur. Ils enchaînent les suites plus vite que les coups, comptant plus sur les dollars que soucieux de marquer des points dans le genre. Le seul et unique Rocky qui surveillait la mutation de son œil de cocker fatigué peut se rendormir. C’est ailleurs, du côté des amateurs, que la flamme brûle encore. Au moins, le jeune Morgan Cooper dans Levitation (2019) a-t-il un peu de gnaque en allant au contact. C’est un peu la démarche inverse du court-métrage fauché et volontairement amateur de l’écrivaine et activiste Dream Hampton qui fit sensation en son temps à Sundance et fut primé ailleurs pour I am Ali (2002), en nous immergeant dans la vie quotidienne d’un petit boxeur. Le talent des comédiens sauvait l’aspect semi-documentaire de la réalisation. C’est d’ailleurs uniquement dans le documentaire qu’elle poursuivra, notamment en produisant Notorious B.I.G. (Bigger than life) (2007).
Notons aussi un film consacré au base-ball, Mr 3000 (2004) qui déjà faisait revenenir de sa retraite une ancienne star des terrains. Décidément une osession de Charles Stone III qui a bien du mal à créer du neuf avec ses vieux. Enfin, l’académisme boit le bouillon se noyant dans les grands sentiments de son Respect (Pride, 2007) de Sunu Goneraqui s‘intéressait à l’histoire vraie d’une équipe de natation afro-américaine d’un quartier défavorisé de Philadelphie.
La croissance constante du nombre de réalisateurs afro-américains entraîne un déferlement plus ou moins fédérateur de film historiques ou disons, à la mode rétro. Hors le totalement inutile The birth of a nation (2016) de Nate Parker, trop appliqué pour avoir le moindre impact politique, peu de films sortent du lot. Tout du moins pourra-ton avancer le côté « professionnel » de leur exécution. Le secret de Lily Owens (2008) de Gina-Prince Bythewood vaut au moins pour son regard féminin malgré un scénario édifiant sur une adolescente blanche (Dakota Fanning) reccueillie par une famille noire de Caroline du sud au début des années 60. Queen Latifah y a reçu des louanges de l’ensemble de la presse américaine pour son interprétation de femme forte. Mudbound (2017) prouve qu’il n’y a encore une fois rien à attendre de Netflix qui gâche le talent de Dee Rees. Et puis il y a bien sûr la grande aventure de la conquête des droits civiques. Hormis le très coincé Selma (2014) d’Ava du Vernay, on peut citer Black august (2007) de Samm Styles sur le Black panther George Jackson, même si centré sur son passage à San Quentin, il relève bien plus du film de prison que du biopic historique. À noter dans ce cadre rural surcadré – mais celui-là contemporain, le beau court métrage de Sanford Jenkins Jr, A craft’s man (2017) qui nous ramène à l’esprit sudiste des film de Parks, Burnett ou Julie Dash.
Toutes proportions gardées, le cinéma indépendant s’en sort plutôt mieux que ceux et celles qui tirent la langue derrière les succès commerciaux des blancs ou de Tyler Perry.
Outre l’apport important de Terence Nance, devenu une référence, on peut noter le modeste Milk money (2011) de Spencer et Styles, entre crime movie et drama dans le Oakland d’aujourd’hui, les films de la très branchouille Janicza Bravo, dont Pauline alone (2014), Gregory go boom (2013) ou Man rots from the head (2016), tous les deux avec Michael Cera, ses films s’affranchissant de toute appartenance communautaire. L’exception est son court en 360°, Hard world for small things (2016) qui par son procédé totalisant prouve l’impossibilité à empêcher le drame – l’attente est même un élément clé de cette distorsion de l’espace – dans une réalité dont on a par ailleurs rendu tous les composants. L’expérience est assez redoutable. Elle est depuis passée au long avec Lemon (2017) puis dernièrement avec Zola (2020) sans dépasser l’aura de Sundance. Durant les vingt dernières années, c’est surtout l’intégralité de l’œuvre de Barry Jenkins qui aura émergé, en particulier ses courts-métrage mais aussi son dernier moins bien accueilli Si Beale street pouvait parler (2019) pourtant plus subtil que les épanchements de Moonlight. Cette année, on a pu découvrir le transgenre Queen and Slim de Melina Matsoukas mais qui relève d’un regard autre que celui des seuls cinémas mainstream ou de genre (polar post Fruitvale station) car centré sur son histoire d’amour. Enfin, Morgan Cooper a réalisé deux courts relatifs aux métiers du cinéma, Room tone (2019), portrait d’un ingé son sur un tournage et surtout, U shoot vidéos (2019) ou les déboires d’un jeune cinéaste, inspirées par son activité de réalisateur de clips de gangsta rap à Kansas City.
Chez Bravo, plus besoin de tourner avec des personnages noirs. Idem pour Jenkins : A young couple (2009) est un regard documentaire sur un jeune couple de bobos blancs. Tall enough (2009) essaie d’expérimenter la mixité des formes sur une histoire d’amour interraciale. Chlorophyl (2011) suit une jeune latina qui perd peu à peu la lumière. à la même époque, la jeune Sosena Solomon, une éthiopienne née à Nairobi mais installée à Philadephie, tourne durant ses études Ming (2009), un portrait documentaire d’un asiatique, artiste des rues new yorkaises. Nous voilà dans le village global et multiracial que nous montre la sitcom It takes a village (2019) de l’universitaire Omowale Akintunde qui paraît toujours plus rigolo que son très conventionnel long-métrage Wigger (2010) où un jeune néo nazi avait pour meilleur ami un jeune noir. Enfin, dans le documentaire Little white lie (2014), la juive blanche Lacey Schwartz mène l’enquête après avoir appris que son père était noir. Parmi les travaux du photographe de Harlem, Khalik Allah, un film, son second court, donne la parole à un blanc marginalisé, qui finalement prêche tout autant que les autre – ou même que le réalisateur – dans Azreal, a 5% story (2006).
Écrivaine et artiste vidéo installée à Brooklyn, mais comme beaucoup d’artistes de sa génération d’origine nigériane, Akwaeke Emezi porte un regard sur son identité et sur celle des autres. Dans une très courte vidéo, Blesi (2013), une femme à moitié noire et à moitié indienne s’interroge sur ses enfants moitié nigérians, moitié malais et sur ce qu’ils retiennent de ces origines. « Quand et où, es-tu entre les deux ? ».
Qu’est devenu le courant si puissant de la Hoodspoitation? Il a a quasimment disparu à de rares exceptions près comme Blue hill avenue (Craig Ross Jr, 2001), le court Cover de Christopher Ellis, le Paid in full (2002) de Charles Stone III à une époque où il n’était pas encore rangé ou récemment le Straight outta Oakland (2017) de Marcus D Spencer. La drogue a par contre été l’un des sujets du film court de Nikyatu Jusu, Black swan theory (2011), plus un beau portrait de fille enfantée par la violence de son pays d’origine qu’un simple polar urbain, mais surtout du très remarqué western urbain de la new yorkaise Nia da Costa, Little Woods (2019). De manière générale, la misère est très rarement traitée, plus elle est répandue, moins elle s’étale à l’écran. Un court comme Heroes wanted (2007) de Marquette Jones semble descendre en droite lignée de Sir Charles Lane (un SDF trouve un bébé dans une poubelle). Il faut donc chérir à leur juste valeur les films de Khalik Allah qui documente quelques blocs, deux trois coins de rue à Harlem, livrant une œuvre documentaire importante. Parce que la photo y est reine- c’est elle qui révèle le personnage et toute sa force intérieure –, tout son montage est organisé vers ces acmées visuelles. Pour le reste, il mélange les régimes d’images, les sources, utilise des effets vidéo, vieillit l’image, rajoute de courts inserts expérimentaux vintage pour donner un goût de pellicule, alors que son travail a plus que jamais la rugosité numérique qui sied à cet hyperréalisme photographique. Particulièrement dans Antonyms of beauty (2013) qui nous donne à entendre la parole (un concert polyphonique avec bruits ambiants, rires de hyènes…) de ces vieux toxicos de la rue, effleurés avec la caméra, pas clandestine mais agitée, pour être figés au meilleur d’eux-même par le déclencheur. Ces Antonyms of beauty, ce sont donc les noces théoriquement impossibles de deux formes d’art au service de la vie et d’un regard plein de compassion sur une partie défavorisée de la communauté noire américaine. C’est toujours la même misère et la même beauté que capte encore le photographe journaliste dans Urban Rashomon (2013), en suivant Frenchie du côté de Lexington avenue.
Pendant ce temps, la police vaque à ses occupations, c’est à dire qu’elle continue d’abattre des nègres, que ce soit dans Queen & Slim, dans le très plat Fruitvale station (Ryan Coogler, 2013) ou le film Black lives matter pour ados, The hate u give (George Tillman Jr, 2018), où la jeune fille jouée par Amandla Stenberg prend conscience de l’injustice contemporaine depuis son cocon doré. Ce néo conservatisme ni l’oecuménisme ne parviennent tout à fait à éteindre l’incendie qui couve. Certes, Hollywood souffle sur les braises quand ça l’arrange. De leur côté, des collectifs comme nation19 avec les cinéastes Queen Mohammad Ali ou Hakeem Khaaliq réalisent des spots satiriques (Boycott Christmas campaign : the family dinner) pour appeler à boycotter Noël. Des francs-tireurs comme Terence Nance réalisent de courts pamphlets comme Blackout John Burris Speaks (2015) qui contient pourtant ses obsessions habituelles. On ajoutera aux thrillers déjà cités le Bunker hill (2008) de Kevin Willmott, une sorte d’Assaut ou plutôt de Bacurau au Kansas et dans des paysages façons Michael Ritchie, le court gentiment féministe de Marquette Jones, Forgiving Chris Brown (2015). On peut mentionner l’ultra classique Luce (2019) du fils de diplomate nigérian Julius Onah, où Octavia Spencer, la version noire de Madea – et qui trouvera son personnage définitif cette même année sous la caméra du bien pâle Tate Taylor dans Ma –, s’oppose à Naomi Watts, mère adoptive d’un ancien enfant soldat. Mais ici, le sous-texte ne serait-il finalement pas plus intéressant que le film lui- même ? Côté vétérans, Nate Parker a incarné une sorte d’American sniper dans le gentiment dépressif court-métrage LU (2013) de Korstiaan Vandiver qui dès son jeune âge manque de mordant. Toujours dans cette vaste opération de blanchiment du cinéma afro-américain délavé par le genre où se retrouvent aux commandes de jeunes hommes de la génération dorée, le même Julius Onah a d’abord réalisé The Cloverfield paradox (2018) produit par JJ Abrams pour Netflix et très fraîchement accueilli. Encore une bande qui ne risque pas de calmer la frustration des fans, car elle ne sait toujours pas comment dépasser Alien. Pire, ils produisent également l’inoffensif produit pour ados, See you yesterday (2019) de Stefon Bristol, dont il vaudra mieux se souvenir de la version courte. Comme dans le cas d’Onah, c’est Spike Lee qui lui a pourtant mis le pied à l’étrier ! Mais le talent est-il vraiment transmissible dans un genre qui connaît une crise majeure depuis plus de 15 ans ?
L’horreur semble plus inspirante (décrépitude du réel après la douche des années Obama sans doute). Le Suicide by sunlight (2019) de Nikyatu Jusu porte en effet quelque chose de plus organique dans toute cette explosion de couleurs en HD et sa relecture du thème vampirique envoûte. On va donc attendre et espérer un passage au long. Le genre inspire aussi Cauleen Smith qui, sans le moindre budget, réalise le curieux et séduisant The changing same (2001). On y songe à la mélancolie des héros d’Only lovers left alive. On aimerait se souvenir avec une certaine tendresse du film de rats invasifs de Leslie Small, Tara (L’invasion des rats, 2001), sorti directement en vidéo là où certains ne voient que la pire des séries Z. Plus loin dans le temps plus que dans le résultat, Jonathan Louis Lewis a commis quelques courts à Oakland (The telephone, 2006, The letter en 2020) mais est surtout responsable du remake improbable et malheureux de Black devil doll (2007). Le bilan serait donc vraiment déprimant sans la réussite insolente de Jordan Peele. Très politique, parfaitement maîtrisé dans son rythme comme dans la balance entre les tons, Get out ! (2017) a été le film d’une génération. N’oublions pas qu’acteur et scénariste, Peele vient de la comédie. Il faut donc accueillir son second essai en tant que réalisateur avec les honneurs qu’il mérite. Us (2019) peut paraître minimaliste et son thème politique et social, tiré par les locks, il n’empêche que dans le désert actuel du cinéma d’horreur américain, il sonne comme un retour aux fondamentaux de la part d’un réalisateur qui apprend aussi son métier, plus que comme une trahison de débuts prometteurs (en revenir à Carpenter n’est tout de même pas une si mauvaise idée). En réalité, il consitue un diptyque parfait avec Get out !, ce cousin blanchot à l’humour si bien sous tous rapports. Coloré et sauvage, il a troqué son look de sitcom pour une flamboyance très seventies. Le discours a par contre gagné en mordant. Normal puisqu’à la peur du devenir blanc se substitue celle de retourner nègre, ainsi que l’évoquent ces râles de douleur pour tout moyen de communication. N’est-ce pas donc cela qui inquiète cette classe noire privilégiée qui a préféré le libéralisme de Trump à un projet social? Même si l’explication finale laisse sceptique, le message passe dans un film viscéral. Il se construit enfin autour du personnage interprété par Lupita Nyong’o, superbe actrice qui illumine à elle seule la noirceur de l’ensemble. Attendons la suite avec optimisme, si la télévision ne le mange pas. Get out Jordan !
En réalité, une crise d’inspiration pèse sur l’ensemble du septième art qui ne parvient plus que très rarement à échapper au formatage de la dramaturgie à l’américaine. Le bilan serait désespérant, parallèle à celui du bilan politique de plusieurs générations successives qui ne cessent de démissionner depuis les crises des années 70. Mais comme on le sait, la résistance couve dans la matrice, il nous appartient d’aller regarder là où on s’essaie encore, loin des écoles dominantes. Un néo psychédélisme fleurit. Plus gentiment, dans le très arty et très branché An oversimplification of her beauty (2012) de Terence Nance, sorte d’autoportrait narcissique d’un artiste « quixotic », autrement dit un extravagant coupé de la réalité, qui narre sa vie et l’histoire d’une déception amoureuse avec force effets visuels de tout genre qui ne font le plus souvent qu’accroitre l’effet de distanciation. Qu’on la déteste ou non, on ne peut pas nier que Nance fasse œuvre poétique, d’Auteur absolu, ce qui est toujours compliqué dans le contexte américain, y compris l’underground. On l’a rapproché de pas mal de choses, lui a découvert des racines afrofuturistes. Parce qu’il est à l’opposé du cinéma narratif américain, on lui a fait un triomphe à Sundance et ailleurs, quand sa sortie française s’est avérée catastrophique. Le portail avec ce qui va suivre? Flying Lotus. On lui doit la bande originale.
Musicien électro bien connu, celui-ci est passé derrière la caméra pour réaliser un film tout aussi barré. Son psychédélisme affamé conserve la narration erratique, mais s’architecture sous forme de blocs fantasmatiques plus que par la voix intérieure d’outre tombe utilisée jusqu’au délire et à peine rythmée de jaillissements de vie de Nance. Moins Beat generation, l’univers de Kuso (2017) est adepte des souillures organiques et cousine du français Mandico. L’hybridité est partout, avec plus ou moins de réussite selon les séquences. Pour ce qui est de l’inspiration, elle est assez féconde et son but provocateur est plutôt bienvenu, dans la grande tradition afro-américaine. L’ OFNI commence par un chant jazz plutôt extraverti qui rencontre la contre-culture issu de la télévision post guerre froide. Il réalise ensuite la scène de sexe africaine américaine la plus érotique mais aussi la plus étrange (et surtout la plus dégueulasse !), avec pustules et glaires. Le film est ainsi très souvent gore, tout en mariant contre leur gré des esthétiques très diverses allant pour le moins bon de Terry Gilliam à Rosto ou autres créateurs de métamorphoses (une séquence japonaise où l’on songe que décidément, la body horror est partout !) Des interludes comiques prouvent en outre un certain sens de l’absurde post lynchien. Quant à ses collages, leur côté brut dépasse tout ce à quoi nous avons été habitués depuis les années 60. S’il y a unité dans le film, elle est forcément esthétique. Tout ce que l’Amérique ne veut habituellement pas voir se retrouve là sous nos yeux. Alors charge ou film surchargé? À chacun son expérience… Pour terminer, citons à nouveau Kevin Wilmott et un film malheureusement vite oublié, Destination planet negro (2013). À la fois concept inversé de Confederate State of America et potentielle variation sur le Iron sky sorti l’année précédente, ce film à petit budget mais plutôt réussi au plan visuel raconte qu’un groupe d’astronautes noirs est envoyé dans l’espace pour coloniser Mars et changer la planète rouge en black planet ! Victimes d’une erreur spatio-temporelle, ils atterrissent de nos jours et vont s’apercevoir que le racisme a toujours cours. Le film est un hommage à l’âge d’or de la science-fiction comme à la télévision américaine, mais n’est pas qu’une satire de plus puisqu’il véhicule toujours un message politique sérieux.
On peut aussi s’enthousiasmer pour les formes marginales d’envergure plus modeste.
Dana Washington est sans doute une des cinéastes performeuses les plus importantes des dernières années. Dans son travail, parce qu’il est noir et afro-américain, le corps est politique. Il est une archive et se doit d’être enregistré et classifié par un regard documentaire. Mais il est dit dans Current state of everything : body as archive (2019), « si tu ne peux pas être libre, sois un mystère ». Ses films décryptent et réinventent. Elle dévoile les conditions de fabrication de ses images, affiche en esthétique l’univers de son écran d’ordianteur, de sa table de montage, de ses fenêtres, de son moteur de recherche… Elle n’est pas dupe de cette soit disant libération et se dit « socialisée par la peur ». Internet, outil et système… Etre femme est évidemment un point important, on y revendique comme essentiel « d’expérimenter le stade femelle ». Mais Dana Washington va plus loin que d’être noire américaine et femme par le travail sur le corps afin de guérir la maladie du coeur et guérir de cet état de rage permanent inhérent à la condition afro-américaine. Travailler sur son psychisme en laissant ses propres rêves l’observer. Elle utilisera en conséquence toutes les ressources audiovisuelles pour parvenir à cette libération.
Jamika Ajalon, bien connue du public français pour ses prestations scénaiques avec le groupe de dub Zenzile, est aussi performeuse et cinéaste afro-américaine. Il s’agit d’exorciser aussi cette double existence de noire dans un monde de blanc ( (), 2012) par un travail corporel et sonore, ensuite par une captation filmique et une variation de la distance à l’objectif qui permet d’explorer les différentes facettes du rituel. Le son y est primordial, primal. Dans Intro to cultural schit-zo-frenia (199 ), il faut exorciser la colère par le rythme et le son des mots par le slam plus que par la littérature (image rémanente d’un livre en flamme, laisser jaillir sa revendication d’afro-américaine et lesbienne. En 2009, elle plonge dans Locations of the mothership jusqu’aux racines livresques et politiques du mouvement des droits civiques. Son cinéma est aussi recyclage au fur et à mesure qu’on progresse par jeu plutôt que par combat, sur la marelle de la vie (N Poem).
Récemment émigrée aux Etats-Unis, la nigériane Akwaeke Emezi est également écrivaine et vidéaste et connue au plan international en tant que performeuse et danseuse. D’où dans Hey celestial (2014), une variation et méditation sur les mots chantés (Ne me quitte pas) des mots écrits associés ou rimés et un dialoque constant entre le corps et le lieu, présence et absence dans un noir et blanc qui refuse trop d’incarnation autre qu’immédiatement poétique.
Jocelyn Taylor @ Jaguar Mary est une performeuse, écrivaine, chanteuse et cinéaste. On peut la voir tout à tour poétesse, prêtresse, philosophe ou activiste. Son travail s’affiche sous toute les formes. De la simple vidéo dansée au film expérimental musical (The sweetest dupe, 2006) en passant par le home movie I am the kingdom (2007) impressionnate pièce de 30 minutes réalisée pour exorciser la mort de son père et qui y comprend d’ailleurs une fulgurante scène de rebirth qui est en soit un manifeste esthétique afro-américain qui relie les époques psychédéliques et contemporaines.
Le film d’art est toujours présent, comme par exemple ce court autoportrait documentaire de l’érotomane Numa Perrier, fondatrice de Black & sexy Tv, dans Crocodile of Varuna (2012). Khalik Allah a fait rapidement évoluer son travail, vers un dialogue constant entre image photographique, son direct et prises de vue réelles plus complexes. Il s’y met presque toujours en scène mais jamais il n’a été plus loin que Slang aperture (2012) sorte de court manifeste de son travail de photographe de la street culture. Le cinéma d’animation est peu présent ou alors dans des formats courts comme dans le magnifique clip réalisé par Hype Williams pour le Heartless (2008) de Kanye West et qui capitalise l’héritage de plusieurs créateurs afro-américains dans un même digest coloré. C’est justement cet art du clip si développé qui enfante des œuvres hybrides où l’on ne sait plus, qui de la musique ou des images mène la danse. Ainsi Kanye West passe lui-même derrière la caméra pour le moyen-métrage musical Runaway (2010). On est d’ailleurs étonnés de voir qu’il commence comme finit Get out : un homme noir court à perdre haleine sur une route en pleine forêt. La biche renverrait elle, à la forêt magique de Bertrand Mandico si elle n’était ici plus proche de Bambi ! S’ensuit une série d’ambiances musicales sur contrepont visuels. Et le kitch s’installe… Que nous montre Kanye West ? Une sorte de festin au paradis, avec un groupe d’oies blanches déguisées en black swans, une assemblée de convives noirs costués de blanc, groupes qui tranchent avec ces magnifiques femmes oiseaux flamboyantes et allégoriques, qui appellent l’éjaculation cosmique finale (véridique). Un fantasme coloré mais franchement pompier. Osera-t-on ringard ? Terence Nance n’évite pas toujours les mêmes pièges, même s’il est plus sobre, par exemple dans son Moonrising (2014) où la sortie dans les bois convoque plus le ressourcement spirituel que la fuite des esclaves. Son clip pour Earl Sweatshirt, No wear no body (2019), coréalisé avec Naima Ramos-Chapman, balance entre un cinéma indépendant de bon goût en 1.33 et le baroque stylisé sur un thème classique (des corps noirs recouverts de peinture blanche). La chanteuse de Washington, Be Steadwell, réalise elle-même ses clips, Mais aussi la plus longue pièce Vow of silence (2018), sur la quête et l’initiation aux amours saphiques d’une jeune femme. Des passages existentiels et graves, y contrastent avec ceux où l’artiste chante, s’accompagnant au violoncelle, et bien d’autres encore. Ses clips (Sage) témoignent d’une recherche bien plus aboutie que chez ses collègues masculins. Mais le clip n’est pas qu’illustratif.
Les pamphlets militants continuent la tradition afro-américaine du slam chez Jamika Ajalon ou chez Royalty, mis en image par Morgan Cooper pour States of America (2019), sorte de clip publicitaire pour les Black lives matter. C’est sans doute que Cooper étant très actif dans la pub, il ne bride pas son goût pour la belle image, réussissant quelques superbes envolées qui donnent envie d’en savoir plus quant à son avenir.
Le champ documentaire est encore à investir. Mais on le sait désormais, l’oeuvre monumentale de sa génération est celle de Kevin Jerome Everson. Elle a mis du temps à s’imposer comme une évidence outre-Atlantique mais la rétrospective organisée l’an passé au 41ème festival du Cinéma du Réel a enfin comblé une lacune, alors que son œuvre était depuis longtemps diffusée dans les festivals américains (et à Rotterdam, Venise ou Oberhausen ou plus discrètement (!) au Centre Georges Pompidou). De cette prolofique production (9 longs-métrages, 160 courts !!), impossible à embrasser d’un seul regard, il ressort une approche plastique unique et différente. Cet enseignant en art et cinéma montre également un travail narratif divergent, qui recherche volontiers la distanciation (recourir à des acteurs, à des situations inédites) et le décalage pour déjouer l’attente vis à vis du sujet traité, mais le tout dans une volonté plus large de documenter dans ses travaux réalisés sur vingt ans, la diversité des vies des afro-américains aujourd’hui, qu’il s’agisse des loisirs (Cinnamon, 2006, sur le sport automobile) de la vie spirituelle (The island of St Matthews), politique (Tonsler park, 2017), économique (Three quarters, 2015) ou du travail (Quality control, 2011), dont il restitue parfois le mode opératoire avec la durée adéquate (les 8h de Park lanes, 2015). Mélangeant captation documentaire (les 8h d’8903 empire, 2016) et reconstitutions, archives et témoignages avec du matériau plus poétique ou expérimental (Tygers, 2014), il cherche toujours une forme : le super 8 charbonneux rend aux gestes de la couturière la façon artisanale de son travail. Le noir et blanc télévisuel désacralise le moment du vote en montrant brutalement l’intimité d’un bureau de vote ou a contrario, rend toute l’intensité de l’instant présent (Black bus stop, 2019. Le sépia redonne une dimension temporelle aux rituels (Erie, 2010), de même que la structure de Quality control embraye sans crier gare sur le quotidien le plus concret des travailleurs. Son approche peut même s’avérer rugissante pour nous immerger dans la passion du sport automobile (Cinnamon).
Face à ce déferlement d’idées, le reste de la production paraît terne. Il faut cependant reconnaître des qualités à Sophia Nahli Allison qui s’attaque aux faits divers tragiques pour un hommage à une adolescente de quinze ans assassinée par un coréen dans une épicerie de South central dans le long-métrage A love song for Latasha (2019) ou au courage d’une mère (A mother’s journey,2016) en plein deuil de trois adolescentes écrasées par un chauffard. Si elle ne refuse pas le témoignage face caméra, au moins cherche-t-elle la forme adéquate pour en restituer l’émotion de la façon la plus violente qu’elle télescope alors avec des recherches formelles plus expérimentales et purement photographiques.
Dans l’intéressant Homegoings (2013), Christine Turner s’intéresse aux rites funéraires. Depuis l’esclavage, les funérailles sont en effet un espace de liberté pour les afro-américains, les blancs s’étant vite débarrassés de ces charges qui leur répugnaient. Le style reste nénmoins très classique, comme 90 % d’une production documentaire didactique orientée vers la télévision qui parvient à se démarquer lorsque son sujet est lui-même passionnant (Beah, a black woman speaks, 2003 de LisaGay Hamilton sur la poétesse et militante Beah Richards). Enfin, il faut signaler, le mockumentary de Kevin Willmott, où l’on retrouve la verve de l’auteur de Chi-raq ou BlacKkKlansman, qui imagine un futur dystopique où les Confédérés auraient remporté la guerre de sécession dans C.S.A. The Confederate States of America (2004) et détiendraient notamment les leviers de l’Histoire américaine, mais aussi celle du cinéma. Mais derrière le révisionnisme malin (Lincoln par exemple, n’aurait pas fait libérer un seul esclave suite à la promulgation d’un amendement resté… symbolique !), la réinterprétation de classiques (faux Griffith, pubs racistes dignes d’un Paul Verhoeven – du type slaveshopping.net ! –, une version « Rodney King » des cavalcades du Sweetback de Van Peebles), il y a la dénonciation d’une réalité politique et sociale en vigueur dans les Etats-Unis du nouveau millénaire. Et si la forme apparente et sage (plus que celle du classique de Brownlow ou des essais historiques d’un Watkins) est celle du gentil documentaire éducatif, la précision du montage et la finesse des reconstitutions fait de C.S.A, un retoutable et brillant brûlot politique qui pointe une discrimination bien réelle et renvoie un Détroit dans les cordes de la bienséance.
Parmi les plus militants, Shola Lynch a tourné Chisholm ’72: unbought and unbossed (2005) sur la campagne présidentielle menée par la noire américaine Shirley Chisholm. Enfin son Free Angela and all political prisoners (2012) a connu un succès international. Le collectif Spookie action tourne lui de courts clips vidéos efficaces comme Black and blue lives matter (2017) et Hakeem Khaalik et Queen Muhammad Ali, toujours avec Nation 19, promeuvent le projet musical #Bars4justice (2015).
Si la moisson paraît maigre comme dirait Donald Sutherland dans un futur atone et à court d’idées, c’est finalement que c’est plutôt dans ses thématiques de prédilection que dans les grands genres américains que le cinéma afro-américain reste le plus pertinent, comme dès le lendemain du patriot act, où Barry Jenkins questionnait l’appartenance à la nationalité dans un premier court-métrage, l’excellent My joséphine (2003). Il reste aujourd’hui encore, et avec raison, le préféré de son auteur.
Pour beaucoup d’afro-américains, le voyage en Afrique reste nécessaire. Pour Blitz the ambassador et Terence Nance, « everyone is born there », excepté le père (créateur ou biologique, ici né à Accra). Il s’agira donc dans Native sun (2009) d’une quête métaphorique des origines avec des apparitions symboliques fortes : cortège funéraires en échasses, personnages masqués ça et là, spectacle d’un gouvernement d’opérette. On a l’impression que Nance touche ici à l’origine de son imaginaire pour l’un de ses films les plus aboutis. Retour pour certains, croisé avec le départ des autres, comme dans le beau Ududeagu (2014) d’Akwaeke Emezi qui disparaît peu à peu du Nigéria et de son propre film, comme un corps noir dans un bain de lait. Mais long est le chemin qui permet la transplantation d’une terre à l’autre, surtout si on a au préalable arraché les corps à leurs racines. Le documentaire écrit par MK Asante 500 years later (Owen Alix Shahadah, 2005) rythme son évocation historique du drame de l’esclavage par des visions subliminales qui en perpétuent le souvenir, conscient que cette trace est aujourd’hui encore la cause principale de tous les déboires des afro-américains. Ce film important, à la fois personnel et pédagogique, toujours très engagé, a aussi pu être beaucoup critiqué. Mais il est essentiel à cette histoire commune des deux continents. Double culture ou plutôt « triple appartenance » selon les mots de Akosua Adoma Owusu, artiste majeure de la dernière décennie, née en Virginie de parents ghanéens. Cette ancienne étudiante d’Everson, ne cesse de travailler pieds et bras dans chaque pays. Américaine, Afro-américaine et Africaine. Elle pourrait rajouter citoyenne du monde tant elle est reconnue dans tous les pays. Exposée à Beaubourg dès 2009, elle a été jurée au festival des 3 continents à Nantes. Dans son installation datant de 2007, Revealing roots, on projetait au dessus d’extraits de la mythique série Roots, l’image de leur remake africain. En 2018, elle tourne le court-métrage Mahogany too, où là encore, un remake africain du classique des années 70 adopte les codes des films de Nollywood (et ses inombrables séquelles). Dans le premier, la différence entre les sexes remplace celle des races dans les rapports de domination. C’est donc maintenant une héroïne que l’on fouette devant la caméra. Signe des temps, l’oppresseur noir, le patron, est maintenant lettré. L’exercice est vite sidérant. Mahogany too relève lui d’une réappropriation de l’esthétique disco capitaliste par une caméra africaine et contemporaine. Dans le sublime Intermittent delight (2007), elle juxtapose des motifs traditionnels présents sur les batiks avec les formes géométriques des signes du progrès. Autant de films qui témoignent de l’enrichissement que lui procure cet héritage. La double culture ou triple appartenance, ou plus encore, ne va jamais de soit. On n’est en effet plus jamais entièrement d’ici ni d’ailleurs. D’où un éternel conflit générationnel. Originaire de Sierra Leone, Nikyatu Jusu en transporte les conflits mais aussi dans son African booty scratcher (2007) l’évolution et la nécessité de maintenir certaines valeurs culturelles et traditions. Mais les traumatismes se transmettent tout autant aux enfants. Dans Say grace before drowning (2011), le court suivant de Jusu, une réfugiée perd pied et tente de noyer sa fille avec elle. Ces films simples et forts ont d’ailleurs été achetés par HBO.
Dans un film historique, l’activiste et chanteuse Bree Newsome réveille la blackness par une apparition tout à fait fantastique au sein de la forêt. Wake (2010) déterre le spectre de l’africanité chez les noirs américains en voie de domestication, une prise de conscience qui n’est ni sans douleur, ni sans danger. La qualité de mise en scène du film a vite créé l’événement. Depuis, Newsome est devenue célèbre pour avoir décroché le drapeau sudiste du palais de l’état de Caroline du Nord à Charleston, juste après la fusillade meurtrière due à un suprématiste blanc dans une église de cette ville. Une action qui lui a valu un emprisonement, mais surtout le soutien de tout le pays, la célébrité ayant aussi un prix à payer. Cette même forêt où les esclaves se retrouvaient la nuit pour continuer à célébrer leurs cultes, est un lieu originaire pour nombre de cinéastes noirs actuels. Terence Nance, toujours lui, exprime ce flottement à sa manière personnelle dans Swimming with your skin again (2015) : passé et présent, corps et esprit, tempête et contrôle, avec comme toujours une prédilection pour une approche à la fois chorégraphique et visuelle. Enfin, dans Boneshaker (2013), la ghannéenne Nuotama Frances Bodomo installée aux Etats-Unis, nous invite au lieu de l’exorcime religieux où était emmenée une petite fille turbulente, à nous plonger dans le bayou pour en faire remonter notre enfant intérieur.
Les films deviennent de plus en plus ritualistes au fur et à mesure de la nécessité de réinventer des coutumes pour leur époque et pour leur futur, comme le fit Maulana (ex Ron) Karengapour recréer l’unité de la communauté noire américaine en lançant Kwanzaa, célébration festive de la foi qui chez les afro-américains et ce, depuis l’éclosion du Black power. Elle s’étend du 26 décembre au premier janvier selon sept principes swahilis. Dans The black candle (2008), MK Asante remet en perspective le mouvement d’émancipation avec la naissance et la popularisation de cette tradition. Un biais passionnant pour aborder cette conquête des droits civiques, ici racontée par la grande Maya Angelou, mais aussi une tradition à valeur thérapeutique qui a depuis essaimée en France. Heureusement, loin du puritanisme religieux, certaines s’octroient le droit de rendre un sens sacré au désir. Haïtienne adoptée par une famille américaine, Numa Perrier continue de réenchanter le corps féminin, mettant en balance sa propre expérience de camgirl à l’adolescence pour traiter de la sexualité chez les femmes ou les couples adultes. Florida water (2014) est ainsi un très beau court plein de mystères où quatre créatures se préparent pour on ne sait quoi, une rencontre, pas impromptue mais pas non plus organisée, avec un amoureux au bord du chemin. Un film aussi sensuel qu’étonnant. Enfin, Dana Washington, dans sa perpétuelle démarche de recherche éminemment personnelle, procède à une sorte d’évocation de ses ancêtres, sorte de ghosts sudistes qui lui permettent de faire remonter ensuite son enfance et de se réconcilier avec l’afro-américaine féministe et lesbienne épanouie qu’elle est devenue. Under bone (2017) est court mais serein. Puissant.
La spiritualité et les croyances empruntent bien des formes, telles ces sirènes dans le Deluge (2015) de Nilja Mu’min, où une adolescente dont les amis se sont noyés dans le fleuve sous ses yeux, voient arriver d’africaines nayades qui tentent de l’attirer à son tour, et leur échappant, se dégage enfin de la mélancolie qui l’engloutissait. Les afro-américains ont fait leurs, tout comme les blancs, les croyances amérindiennes dans les forces vitales de la Terre. Le Seed (2009) de Jaguar Mary est une célébration du maïs et de la spiritualité hopie où s’opère en une orgie naturaliste la jonction avec le travail actuel de bien des cinéastes autochtones de la même génération. Mais de manière générale, la religion est présente partout et cimente l’identité de la communauté. Les films sur le sujet ne manquent pas mais citons les approches originales de Russ Parr (plutôt connu pour sa contribution à la télévision) dans The undershepherd (2012) où deux prêtres s’affrontent pour savoir lequel représente Dieu et lequel est vendu au Diable ! Enfin, il faut marquer d’une pierre blanche l’excellent court-métrage d’Adamma Debo, Honk for Jesus Save your soul (2018) où le chef d’une congrégation religieuse et sa femme se voient obligés de racoler les fidèles à la suite d’un scandale qui a vidé leur église. Il y a ici un vrai travail sur l’esthétique des gospels films comme sur le discours, avec en prime une réinterprétation délicieuse de la figure du Pimp. Un cinéaste prometteur après seulement trois courts. Khallik Allah a tourné deux films de ses voyages en Jamaïque. Le premier, Khamaica (2014), peut être vu comme un simple carnet de voyage, assez sophistiqué sur le traitement de l’image mais qui garde la fraîcheur de la découverte. Le second est un véritable documentaire et pour une fois, sans images fixes, que son auteur décrit comme une simple lettre d’amour audiovisuelle à la Jamaïque. En réalité, Black mother (2018) cherche à capter la force spirituelle de ses habitants au-delà du portrait de l’île fourmillant de vie par un montage polyphonique. Un grand film spiritualiste. De par son origine éthiopienne, la religion est un des aspects les plus importants des courts- métrages étudiants de Sosena Solomon. Ipray (2010) est un hommage à la force de la pière, à travers des centaines de fidèles de confessions différentes et dans un noir et blanc envoûtant. Dédié aux new yorkais qui croient, Mitzvah tank (2010) est un film qui porte un regard inhabituel sur le judaïsme, en se concentrant sur un bus de prière affrété par des orthodoxes juifs qui l’utilisent en pleine ville pour rameuter les fidèles. Un regard chaleureux qui nous montre à quoi se dope cette petite éthiopienne pour survivre en Amérique. Qasim Basir a lui aussi réussi à déjouer les clichés habituels en réalisant un long-métrage sobre au coeur de la communauté musulmane plutôt rigoriste au lendemain des attentats du 11 septembre, Mooz-lum (2011) avec Danny Glover. Enfin, Nilja Mu’min s’intéresse dans son premier long-métrage Djinn (2018) à une adolescente confrontée au changement brutal de personnalité de sa mère, présentatrice météo convertie à l’Islam. Enfin les clips de Nation19 concilient hip hop, Malcom X et islam (One minute nineteen seconds of your life).
L’Afrofuturisme peut aussi être amené au compte de ces nouvelles spiritualités et mythologies, comme une philosophie positive qui a permis aux afro-américains de dépasser les barrières sociales et raciales habituelles. Ce courant est présent dans la littérature, la musique, la BD, le cinéma, les clips et évidemment dans la technologie et plus généralement, à travers les travaux de chaque inventeur noir. Selon la définition d’Ytasha Womack (Post-Black: How a New Generation is Redefining African American Identity, 2010), l’Afrofuturisme se touve à l’intersection de l’imagination, de la technologie, du futur et de la libération et permet de redéfinir la notion de négritude en combinant des éléments de science-fiction, de fiction historique, de fiction spéculative, d’afrocentrisme, de fantaisie et de réalisme magique non-occidental. Sa vision du monde est fondée par une conception de la temporalité cyclique (héritage par exemple de la cosmogonie dogon ou égyptienne) et d’identité post-humaine. Il se nourrit de la diaspora africaine comme des romans d’Octavia Butlerou aujourd’hui Nnedi Okorafor. Musicalement, on va de Sun Ra et son Arkestra à Lee Perry et George Clinton, en passant par Grace Jones ou Jeff Mills. La confiance dans les nouvelles technologies et le numérique découle de l’idéologie californienne (capitalisme techno-libertarien), mais en offre souvent une lecture critique. L’afrofuturologie a pu ainsi être comparé à la mystique de l’espoir au quotidien introduite avec la campagne d’Obama, vue comme un élément de résilience contre l’idée de finitude (destruction de la planète à la fin de Space is the place -1974, John Coney).
On peut évidemment remettre en question le fait que ladite philosophie soit issue des marqueurs raciaux et limités par ceux-ci. Ainsi que le dit Cauleen Smith, « blackness is a technology. It’s not real. It’s a thing » (voir son Demon fuzz, 2010 qui réinvente un psychédélisme organique contemporain) quand après l’émergence de black power et dans les années 70 on parlait fréquemment de Liquid blackness pour évoquer cette croissance de la conscience africaine américaine. Il s’agit donc d’opposer une construction libératrice à celle de l’infériorité raciale issue de l’esclavage et majoritairement développée par le monde occidentale (une Afrique sous-développée et incapable de s’adminustrer elle-même). Bien que la polémique aille bon train sur la portée révolutionnaire (plus particulièrement depuis Black panther en 2018) et même la réalité de ce « mouvement », plus particulèrement dans le septième art, Cauleen Smith semble être pertinente lorsqu’elle définit sa mission comme une invasion du présent par des futurs constitués de révisions du passé. On peut légitimement critiquer la réappropriation à des fins apolitiques du symbole Black panther, mais il n’empêche que même le film de Ryan Coogler travaille malgré tout à subvertir les anciennes mythologies en en réinventant une nouvelle plus égalitaire (« T’Challa représente… un Africain qui n’a pas été affecté par la colonisation » dixit le réalisateur) . N’oublions pas que le courant afrotuturiste obéit à une nécessité universaliste car en tant qu’objet, le nègre fut le tombeau de l’homme, « le fantôme qui hante le délire humaniste occidental » comme l’écrit Achille Mbembe. Certes Black panther est esclave de sa production et les artifices numériques sont ses chaînes. Il semble naître d’un modèle totalitaire (post humain donc ?) et d’une esthétique nouvelle mais ici diluée par le mainstream, polluée par le consumérisme. Pourtant, à bien y regarder, le look Marvel détourné, ou plus exactement repeint aussi simplement qu’on change son fond d’écran, par Coogler n’est pas si éloigné de la crème des artistes africains (la kenyane Jacque Njeri et le projet MaaSci…). En outre, ses racines remontent sans aucun doute au film manifeste de Sun Ra, Space is the place, où il s’agit de transporter la communauté afro-américaine des ghettos vers une autre planète par le seul pouvoir de la musique. Une œuvre de bric et de broc qu’on ne sait jamais à quel degré prendre – Sun Ra torturé par le FBI à coup de morceaux country !- tant on pourrait croire à un cousin des Monty Python alors que sa mystique comme ses prophéties sont mues par une croyance réelle, militante.
Une autre caractéristique de la veine plus contemporaine de Black panther est elle issue du courant « féminin sacré dans l’espace » ? En effet, le mouvement féministe afro-américain a été travaillé par la même nécessité de réinventer les rapports entre les genres (Jaguar Mary pour The sweet dupe, (2006) détournement façon conquête du spectacle et société de l’espace, Cauleen Smith dans The green dress (2006), thriller sci-fi expérimental qui pourrait faire songer à du Miike). On ne peut minimiser le succès phénomène aux Etats-Unis et écarter d’un revers de main les effets sociologiques qu’aura le film dans un pays où le racisme fut autant institutionnalisé (self empowerment, self transformation contre martyrologie, stérilisations forcées, eugénisme…). Il peut en outre amener un public à s’intéresser à des films oubliés (voir le documentaire Black sci-fi de Terrence Francis) et à découvrir d’autres œuvres plus personnelles qui fleurissent ça et là avec les courts-métrages de la britannique Jenn Nkiru tournés aux USA (le fascinant clip expérimental Rebirth is necessary –2017), l’excellent Black to techno, 2019 qui s’intéresse plus particulièrement à l’apport des D-jettes de Détroit ou encore En vogue (2014), où les ballroom relèvent ici du même fantasme de transformation extatique de l’humain), Nuotama Frances Bodomo qui réinvente l’étoffe des héros en racontant l’aventure de la conquête spatiale au Zimbabwe dans le magnifique Afronauts (2014), représentant le plus éminent de la veine « Tatooine » (futur et dénument) ou à la pointe, le film interactif d’Ayoka Chenzira qui a préféré le multimédia au film plus classique au tournant des années 2000, HERadventure, proche en esprit des réalisations des canadiennes d’Abtek (aboriginal territories in Cyberspace), sauf qu’ici il peut être accessible sous forme de jeu et plus simplement d’histoire (un récit extra-terrestre féministes et écologiste) selon le média par lequel on y accède (instagram, facebook, téléphone…). À bien y regarder, sa première scène où l’on déracine des arbres par la force de l’esprit pour en extraire de la vie est un condensé des vélléités afrofuturistes. Voir aussi la fantaisie hybride Sita (2012?) de Tchaiko Omawale et ses fées androgynes, avec les images de l’incontournable Bradford Young (chef op afro-américain de Premier contact ou Solo mais également réalisateur de clips pour Common). Dans la situation particulière que nous vivons aujourd’hui, l’afrotuturisme offre une base de réflexion car toujours selon Achille Mbembe « tout ne peut pas être calculé arithmétiquement, vendu et acheté ; tout n’est pas exploitable et substituable ; un certain nombre de fantasmes pervers doivent nécessairement faire l’objet de sublimation si l’on ne veut pas qu’ils conduisent à la destruction pure et simple du social ».
On ne peut réduire l’émancipation féminine à ce simple courant, aussi important et innovant soit-il. Les femmes ont pris leur place dans les récits, comme dans le joli court, sans doute très classique de la star de Precious, Gabourey Sidibe, The tale of 4 (2016) qui avant Kelly Reichardt proposait quatre portraits de femmes en histoires croisées inspirée par la chanson de Nina Simone. Pour Sophia Nahli Allison, il s’agit du portrait en diptyque de sa mère dans une mise en scène ébouriffante et émouvante de Portrait of my mother (2018). Elle tourne aussi le court documentaire Hashtag revolution black magic (2017) qui nous fait partager l’énergie de la créatrice de la page facebook destinée à rendre leur fierté aux femmes noires. Avec succès. Les femmes prennent dorénavant les armes dans Lila & Eve (2015), un heist film de Charles Stone III dont Steve McQueen saura se souvenir pour tourner Les veuves. Elles ne portent évidemment pas le même regard sur la prostitution comme dans le très touchant Round of both sides (2011) de Marquette Jones sur une femme qui n’arrive pas à raccrocher. À des années lumières d’un petit gangsta film comme Livin the life (2002) tourné dix ans plus tôt par Joe Brown à Compton. Et puis il y a le cortège de violences et le harcèlement, en particulier le trop peu connu Aissa’s story (2013) réalisé par la nigériane de naissance Iquo Essien à partir du viol de Nafissatou Diallo par Dominique Strauss-Kahn. Sans doute une histoire qu’en France on a tout intérêt à oublier… Pour la cinéaste Naima Ramos-Chapman dans And nothing happened (2016), c’est l’agression sexuelle dont elle a été victime qu’elle ne peut oublier et qu’elle traite ici uniquement par l‘après, dans un enchaînement d’états émotionnels extrêmes (désir violent, ennui, agressivité, dépression). C’est dans cette proximité avec la jeune femme qu’on prend peu à peu conscience du drame intérieur et des conséquences sur son environnement immédiat. Un court très intense et fort.
Si comme on l’a vu, aucun cinéaste afro-américain quelqu’il soit n’est totalement avare en matière de sexe (Tyler Perry?), ce sont les femmes qui mettent la barre le plus haut et en parlent sérieusement. Toujours avec Numa Perrier dont le Jezebel (2017) pour Netflix montrait sans fard mais avec une certaine tendresse une adolescente gagner sa vie comme camgirl. Puis dans son court-métrage La petite mort (2019), elle inverse les clichés de la Blaxploitation dont elle reprend un thème musical, pour montrer le parcours fantasmatique d’une femme en route vers un gang bang (consommé ou non, qu’importe) quand les maquereaux des années 70 trônaient eux au milieu de leur cheptel (Truck Turner de Jonathan Kaplan). Mais il y a d’autres cinéastes pour traiter différemment d’autres problèmes : la frustration sexuelle et le voyeurisme, mais aussi la solidarité entre voisines dans Solace (2015) que Tchaiko Omawale transformera ensuite en long. C’est d’abord le choix de sa sexualité, dilemme que met fort bien en scène A-lan Holt dans Inamorata (2018) comme avant lui Be Steadwell (Vow of silence). Les amours entre filles se retrouvent dans un grand nombre de films, notamment ceux situés à l’adolescence, à commencer par le Pariah (2011) de Dree Rees qui vaut pour la proximité avec ses jeunes comédiens et une très belle photographie qui déjoue les pièges du naturalisme propre à ce genre de chronique, dans un scénario hélas plus balisé. Tayarisha Poe en a fait le sujet de son court-métrage Honey and trombones (2012) qui a vite perdu son ton indépendant dans son long-métrage tourné l’an passé pour Amazon (Selah and the spades), avec son féminisme lycéen revendicateur mais à bien y regarder, assez consensuel.
Le harcèlement subi par les orientations d’un enfant plus jeune est traité dans A long walk (2014) par la brutalité du père qui traîne son gamin atifé en fille devant tout le quartier, la brimade provoquant une issue fatale. Un court plus sensible qu’édifiant de la nigériane d’origine Chinonye Chukwu, ayant réalisé deux longs-métrages dont le grand prix de Sundance en 2019 sur une femme bourreau de profession (Clemency).
Le cinéma queer s’est développé avec une belle vivacité, Moonlight étant évidemment le sommet de la reconnaissance hollywoodienne pour Barry Jenkins et toute une communauté. La majorité des productions est de format court, souvent transdisciplinaire et flirtant avec l’underground. Ecrivain, performeur et chorégraphe bien connu, Brontez Purnell a aussi réalisé rapidement pour un événement ponctuel le beau court-métrage indépendant dans un noir et blanc granuleux et langage châtié 100 Boyfriends Mixtape (The Demo) (2017). Une manière intime d’évoquer l’isolement provoqué par le SIDA à travers l’évocation au téléphone de nombreux amants fantômes. Tiona Nekkia McClodden ne mâche pas ses mots et appelle la diaspora africaine le « black mentifact ». Elle a justement basé son travail sur les problèmes de race, de genre et de sexualité. Son court expérimental The Labyrinth 1.0 (2017) tourné à la même occasion mélange les sources mais aussi les corps dans l’espace cru d’une pissotière. Enfin, la cinéaste expérimentale de Brooklyn Ja’Tovia Gary livre avec Cakes da killa : no homo (2015) un magnifique portrait documentaire du rapeur homo militant du même nom. Ses autres films plus longs et ambitieux restent à découvrir. Plus sobre que d’habitude, Sophia Nahli Allison suit dans Prom king (2016) un ado trans pour qui le bal de fin d’année n’a pas vraiment la même portée que pour les autres adolescents. Dream Hampton a réalisé le très engagé Treasure: From Tragedy to Trans Justice Mapping a Detroit Story (2015) sur le meutre d’un jeune trans de 19 ans où la police était impliquée. L’identité trans a elle aussi son réalisateur fétiche, l’activiste et écrivaine Tourmaline (@Reina Gossett), à qui l’on doit le court biopic de l’activiste trans Marsha P Johnson, Happy birthday Marsha ! (2017) ou le flamboyant court Atlantic is a sea of bones (2017) qui suit le performer new yorkais Egyptt LaBejia. Le SIDA est enfin présent dans bon nombre de courts. Kia LaBeija évoque la mémoire de sa mère décédée quand elle était encore adolescente dans Goodnight (2017), film mi clip, mi expérimental, intime qui évoque son passé et cette absence actuelle de façon assez simple mais déchirante. Elle continue depuis d’aborder la maladie à travers son parcours d’artiste, ayant été une des seules artistes noires américaines à être née avec le virus.
L’enfance et ses désillusions est toujour présente, pour le meilleur dans la chronique sudiste de Tina Mabry, Mississippi damned (2009), dont l’action est située dans les années 80 et 90 dans un état rural en crise. La situation sociale pèse sur les familles et les gamins doivent affronter de nombreux problèmes. Le film a entre autres qualités, une certaine authenticité dans la peinture de son milieu, ce qui fait déjà beaucoup. A different tree (2012) de Steven Capple Jr, malgré son côté coloré et mignon (esthétique reprise dans The land son premier long en 2016 qui vire au polar) traite de la séparation des parents à travers le quotidien d’une fillette de huit ans. Mais le film peine franchement à décoller en dépit du savoir faire indéniable du metteur en scène, hépas parti continuer la franchise Creed.
Les personnages féminins semble aujourd’hui dominer les années collège et lycées, par exemple dans Seventh grade (2014) de la new yorkaise Stefani Saintonge, un coming of age en milieu scolaire, au thème très classique et dans l’air du temps (bullying), mais qui en fait quelque chose de plus original. Douée pour la direction d’acteurs, elle a depuis tourné d’autres films de fiction ou documentaires.
Portrait doux-amer d’une jeune fille de douze ans qui commente l’évolution du couple parental, Dream (2015) de Nilja Mu’min confirme la sensibilité de la réalisatrice et révèle la formidable jeune comédienne Aramé Scott. Chez les grandes, les problématiques se font plus graves mais le ton moins juste, surtout dans le Yelling to the sky (2012) conçu à Sundance par Victoria Mahoney, que Zoe Kravitz ne parvient pas à sauver des clichés, ni la pauvre Gabourey Sidibe qui vaut bien mieux que ce qu’on lui offre à jouer même si elle et son personnage constituent l’unique intérêt du lénifiant Precious (2009), à la mise en scène en toc du déplaisant Lee Daniels. À noter aussi le court-métrage de Sontenish Myers, réalisatrice d’origine caribéenne, Cross my heart (2017), son quatrième et dernier court dont l’action se passe en Jamaïque durant les vacances scolaires. Une ado vivant aux Etats-Unis y découvrira que les choses ont bien changé dans sa famille. Un regard adolescent et pudique sur le poids du secret.
De petits projets envahissent le web et tentent de traiter à égalité les points de vue féminin et masculin. Kojo Anim tourne dans le plus pur style des web séries (diffusé sur The Black magic network) le diptyque Boys (2017), le meilleur qui met en scène des femmes au téléphone dans leur univers urbain puis Girls (2017) sur le même mode. R M Moses tourne lui son jumeau Pride and pack, cette fois sur un groupe de filles dans Pride of lions (2017), puis un groupe de mecs discutant autour de la paternité dans Pack of wolves (2017). Ici le minimalisme sert assez bien des comédiens souvent excellents.
Terminons justement sur une thématique aujourd’hui propre aux deux sexes et dont les premières évocations dataient des années 80 avec Larkin ou Chenzira. Il s’agit de la mythique chevelure afro, thématique qui a permis à Akosua Adoma Owusu de voyager du Ghana en Amérique et vice versa. En 2009, Me broni ba était la chronique documentaire mais dans une esthétique ébouriffante d’un salon de coiffure à Kumasi, Ghana et remporte de nombreux prix. Split Ends, I Feel Wonderful (2012) explore avec des moyens cinétique les modes en matière de coiffure durant les années 70. Enfin son dernier court, White afro (2019) explique comment donner un air afro aux cheveux des blancs. Tourné à Marseille (filmé dans un style personnel, un mélange de naïveté à la Jeunet et de ciné indé new-yorkais quand il s’exporte et découvre le côté rétro de la vieille Europe), le curieux Univitellin (2016) de Terence Nance dont l’action se situe dans un salon de coiffure montre bien comment au départ, la chevelure unit la diaspora africaine. Sur le plan plus didactique Sophia Nahli Allison a un work in progress en cours, The color complex, une série dont le volet sur la coiffure est absolument passionnant. Untangling: The Politics of Black Hair (2018) grâce à l’ethnographe Yaba Blay, qui nous explique à quel point toute la société est imbriquée dans la coiffure afro. Aujourd’hui, la tendance est différente. Le sujet est souvent : la garder ou non, comme dans le premier court-métrage de Ryan Coogler, Locks (2009) tourné à Oakland dans un style caractéristique. Dommage qu’il soit plus à l’aise pour filmer le cadre urbain que la chute de son histoire, sans doute plus émouvante sur le papier.
Dans Current state of everything : body as an archive (2019), Dana Washington prèfère faire tout le contraire et filmer le rituel. Si le corps garde la trace, faire le sacrifice de sa chevelure est un moyen d’effacer l’ardoise, un choix politique qui met un terme à un cycle. A l’opposé du tout mignon court-métrage oscarisé de Matthew A Cherry (BlackKklansman), Everett Downing Jr (Up) et Bruce W Smith (Cool attitude), Hair love (2019) qui joue à enchanter le public blanc avec ce symbole de l’identité noire, Washington préfère briser un tabou ultime rejoignant les cinéastes féministes, quers ou trans qui comptent parmi celles et ceux qui bouleversent le plus les formes cunéma afro-américain actuel.
Aux deux extrémités de l’arbre afro-américain, la même sève et des traitements aussi différents qu’il y a de fourches ! Mieux vaut continuer à défricher plutôt que de courir après la dernière sensation du cinéma américain classique, car cette quête là, le système l’épuise toujours trop vite. La vitalité et la diversité sont pourtant là…
Un essai de généalogie cinématographique qui n’existerait pas sans l’indispensable n°738 des Cahiers du cinéma et son Histoire des cinéastes Noirs Américains (et accessoirement le n°756 et l’excellent n°757 et son Histoire des réalisatrices) mais aussi avec la programmation 2019 du festival des 3 contients de Nantes : Le livre noir du cinéma américain et l’éditorial de Jérôme Baron, certains n° des années 60 et 70 de la revue Cinéma, les travaux de Régis Dubois, Julien Sévéon, Linda Williams, Camille Bui, Alessandra Raengo, le toujours très exhaustif Sport et cinéma de Julien et Gérard Camy ,Afrofuturism The World of Black Sci-Fi and Fantasy Culture de Tobias van Veen (université Mc Gill), le catalogue L.A. rebellion, creating a new black cinema… J’en oublie d’autres, beaucoup de sources web, mais sans les ouvrages qui n’ont pu arriver à bon port !