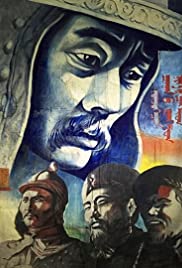Lieu
L'Ancr'ier Voir sur la carteCategories
Atelier cinema , conférence , Mondociné 2020-2021 , Mondociné 2021-2022 , Saison 2021-2022En 1994, le festival des 3 continents à Nantes intitulait sa rétrospective mongole « Découverte d’une cinématographie lointaine et inconnue ». En 2018, dans les pas de Bastian Meyresonne, son directeur artistique, le FICA de Vesoul repartait à la source et enrichissait notre paysage du patrimoine mongol (ici celui de la Mongolie extérieure, actuel état de Mongolie et non de la partie chinoise) partageant un même constat : l’âge d’or du cinéma socialiste a accouché d’un beau nombre de films (350 jusqu’en 1989) avec quelques chefs d’oeuvres et cela même en dépit des sous-genres très codifiés autorisés par l’état socialiste qui exercera d’ailleurs un contrôle strict et total des œuvres produites par le studio national. Puis survint la démocratie… Et le dragon chinois fit à nouveau oublier l’ours russe, le néo-libéralisme et sa prolifération de sociétés produisant à bas coût pour le marché intérieur d’où une déperdition des talents. Il convient de relativiser ce bilan contrasté à la lumière de chaque œuvre (et avec prudence en l’absence de versions sous-titrées hors festival !!), de chaque parcours de cinéaste et bien évidemment, dans la limite de nos connaissances sur la culture mongole.
On dit que son éloignement a isolé la Mongolie du reste du monde, politiquement, économiquement et culturellement. Pourtant, il semble que les toutes premières projections du cinématographe eurent lieu en 1903 via les boutiques des commerçants chinois. Dix ans plus tard et après l’autonomie de la Mongolie dès 1911, le prince Namnansuren et le Bogdo Gegeen (dalaï lama mongol) se font projeter des films à la capitale, Urga (une séquence similaire sera mise en scène dans le superbe Les cinq couleurs de l’arc en ciel de B. Nagnaidorj en 1978). Mais c’est vraiment après la Révolution socialiste de juillet 1921 et dans les pas du voisin soviétique que le cinéma (alors surnommé « spectacles d’ombres ») apparaît comme le meilleur outil de propagande du nouvel état socialiste. Les films russes sont alors diffusés par les nombreux cinémas itinérants. La Mongolie va dès lors rester sous l’influence de son puissant voisin jusqu’à la perestroïka, pour le meilleur comme pour le pire. Et le meilleur, c’est d’entreprendre d’utiliser le cinéma comme une arme d’éducation des masses…
En 1934, ouvre le Ard (qui signifie peuple), première salle de cinéma de Oulan-Bator. Grâce au soutien économique et aux techniciens russes, le studio Mongol kino ouvre lui ses portes en 1935. Il contient un laboratoire, des studios, des salles de montage ou de projection et des ateliers pour les décors et costumes. Il chapeautera jusqu’en 1990 l’intégralité du cinéma mongol, avec ses corporations (scénaristes, cinéastes), entièrement aux ordres.
Le premier film entièrement mongol sera Le chemin de Norjmaa (1938) de Temet Natsagdorj, formé en Allemagne et vite disparu dans les purges du staline mongol, Kh. Choibalsan, d’abord chef de la police politique et qui prend le pouvoir de 1939 à 1952. On trouve dans Norjmaa un des plus grands thèmes d’alors : le conflit entre médecine contemporaine (représentée par une infirmière russe) et croyances locales (lamas, shamanisme…). De fait, c’est bien vers le clergé bouddhiste que vont se diriger les grandes purges : 20 000 lamas seront exécutés et 700 monastères détruits.
Durant la 1ere époque du cinéma mongol, de nombreux cinéastes soviétiques séjournent au pays, surtout après le démantèlement des studios ukrainiens résultant de l’invasion nazie. Les jeunes mongols formés en URSS commencent à tourner grâce à des coproduction avec l’URSS. Le public fait un triomphe à ces biopics épiques sur des héros légendaires. Son nom était Sükhe Bätor (1942, réalisé par plusieurs cinéastes) retrace la vie du héros de la révolution Damdin Sukhe-Bator, surnommé le Lénine mongol. Typographe dans l’imprimerie, il fut touché par les idées bolchéviques. Il crée un cercle révolutionnaire composé de membres d’origines sociales variées (lamas, nobles, fonctionnaires…) que le Komintern fera fusionner en Parti Populaire Révolutionnaire mongol avec le goupe de Choibalsan. Ils se rendent en Russie pour demander de l’aide contre les chinois qui occupaient la Mongolie depuis 1919. Chef de guerre de l’armée révolutionnaire, il reprend Urga occuppée par le russe blanc Ungern Sternberg et les forces chinoises soutenues par les japonais. Ils laissent au pouvoir et ce jusqu’à sa mort en 1924 le Bogdo Khan (chef religieux des bouddhistes donc). Sukhe-Bator meurt à trente ans et différentes versions de sa mort circulent. La capitale est rebaptisée Oulan bator (« héros rouge ») en son honneur et sa veuve devient présidente par intérim.
Réalisé par plusieurs cinéastes mongols et russes, Prince Tsogt (1945) est filmé par l’opérateur D. Jigjid qui va devenir par la suite l’un des cinéastes les plus importants du cinéma mongol. Il reçoit ici à 26 ans le titre d’ « artiste émérite » pour ces images de longues colonnes de soldats qui s’étirent jusqu’à l’horizon nous ramenant à Eisenstein, de même que le typage des personnages vient lui aussi du cinéma soviétique. Il recevra le titre de « cinéaste du siècle » distinction qui lui vient de son talent de photographe comme de son soucis du détail véritable. Cette fresque historique met à l’honneur ce prince du 17 ème en lutte face à l’agression Mandchoue. Le message final ultra nationaliste est fait pour contenter le peuple. Mais le scénario contient plusieurs mises en garde vis à vis des traîtres, notamment contre ceux qui pourraient être tentés de défendre le clergé bouddhiste. Aujourd’hui encore et d’après le récent sondage réalisé par un journal local, ce film est considéré par les spectateurs mongols comme un de leurs plus grands titres, mais est d’un rythme plutôt lent pour séduire complètement les occidentaux, plus proche d’un Kurosawa sur son versant théâtral que d’Alexandre Nevski. On est tenté de le rapprocher également d’autres productions semi-nationalistes du même genre, réalisées à l’époque dans les républiques soviétiques (en Ouzbékistan ou chez le cousin du Kazakhstan). Il permet également de constater les liens culturels forts avec la Chine. On peut encore y voir une représentation du Naamdan, fête de l’été (ou ensuite fête de la Révolution), avec la danse des lutteurs, mais toujours montrée très brièvement. De même qu’est ici évoqué le nom glorieux mais tabou de Genghis Khan à travers son sceau sacré et son épée (voir Premendra Mazumber).
Prince Tsogt (1945)
Mais ce premier âge d’or prend fin avec la guerre et surtout avec celle des crédits soviétiques alloués aux pays frères et la production se voit mise en sommeil jusqu’à l’éclosion d’une nouvelle génération et de l’arrivée de la thématique ouvrière, encore peu répandue chez cette population d’éleveurs nomades. La tendance est au travail et à l’exultation de la plannification. Programme unique, il s’agit pour tous de participer à l’essor économique national. C’est Nouvel an (1954) de Tseveeny Zandra qui ouvre le bal, fortement influencé par l’expérience documentaire de son auteur, ce qui se ressent dans l’attention portée au travail ouvrier et à la peinture du quotidien des gens simples. Toujours dans un cadre urbain, Harmonica (1963) de Bayandelger Jamsran est également un des films phares de la période et qui confirme l’engouement du public mongol pour des sujets plus contemporains. De son côté, Jigjid tourne notamment Le messager du peuple (1959), continuant ainsi le genre historique.
En 1955, c’est le dégel en Mongolie et la bonne humeur revient à travers des comédies et des comédies musicales à partir de l’inégal Notre mélodie (S. Oyun, 1956). Après une belle introduction en paysage aride, le scénario alterne sur un semblant d’idylle artificiel des séquences folkloriques malheureuses plombées par des chorales qui lorgnent poussivement vers la Russie et d’autres passages musicaux de valeur aléatoire sur fond de décors mongols socialisants. Très mal gérée, la direction d’acteurs montre une population exsangue, singeant une image du bonheur au sortir des années Choibalsan, bien plus qu’un véritable printemps cinématographique. Et pourtant ces comédies connaisssent un grand succès, par exemple Le réveil (S.Guenden,1957, toujours avec Jigjid à la caméra et d’après L.Vandan et Tch. Tchmid), avec des passages comiques ou chantés mais toujours sur ce thème social inépuisable de Norjmaa. Khukhuu est sur le point de se marier (Jamsran, 1962) fait aussi partie de cehaut du panier. Ravjaa Dorjpalam s’affirme comme un maitre du genre avec le grand classique satirique Nous avons toujours des difficultés (1956), qui sous l’influence de la comédie kolkhozienne soviétique, relate les déboires d’un homme à la recherche d’une pièce de moissonneuse-batteuse. À la fois picaresque et avec quelques digressions romantiques, ce moyen métrage moque la bureaucratie comme toujours accusée en lieu et place du pouvoir, des différences entre les idéaux et la réalité. Contrairement à Oyun, Dorjpalam maîtrise dès ses débuts le rythme de son film. Les influences, notamment américaines, des films visionnés durant ses études au VGIK sont évidentes. En Mongolie, ce sous-genre agricole fera florès, les tracteurs en étant comme chez leurs cousins et mentors (La terre, La ligne générale pour les exemples les plus célèbres) les véritables héros mécaniques. En 1958, c’est encore Dorjpalam qui signe le tout premier film pour enfants, Trois amis et de très belles images. Ici éclate son sens évident de l’action, par exemple dans l’attaque au lasso par les bandits dissimulés dans une grotte, bien supérieure aux aventures d’un Bulldog Drummond dont il partage le minimalisme. Il n’a pas son pareil pour la resituer dans l’immensité du paysage, comme dans la scène de l’ascension des enfants ou dans celles de fuite de la grotte. Il réalise donc ici un beau film d’aventures, au thème basique mais au rythme très prenant.
Parmi les sujets agricoles, Elbeg deel (Deel abondant, 1960) de Bayandelger Jamsran et écrit avec Jamyanguyn Buntar, sur une éleveuse et journaliste qui décrit avec humour son fainéant de mari. Jamsran est un des meilleurs représentants de la génération des années 60. Il remettra le couvert pour un des plus beaux films mongols situé en région aride, Le garçon de la capitale, une romance rurale qui tire le meilleur parti de l’espace et d’une belle mise en scène, proche mais discrète (plans subjectifs en chameau coulés dans le montage). Outre le fait qu’il nous montre comment une femme fait subsister, de par son travail, les quatre personnes de sa famille, le film est un document intéressant sur l’élevage des chameaux, cet animal popularisé par le cinéma mongol de sa partie Gobi. Le film souffre peut-être un peu d’un côté fleur bleue, pas désagréable d’autant que l’interprétation du couple principal est excellente. Signalons le film de fin d’études de Jigjidsuren Gombojav, Le premier pas (1969) qui va en inverser le postulat : une étudiante en lycée agricole envoyée à la campagne tape dans l’oeil d’un jeune homme du cru. Elle maîtrise parfaitement le tracteur – pourtant mis en échec par la nature « mouvante » des sols -, moins les méthodes traditionnelles. Son départ brisera le coeur de son prétendant. Le scénario épingle les différences entre théorie et pratiques agricoles en prenant l’exemple des foins. Il est d’ailleurs fort instructif dans la peinture des travaux agricoles, et ce jusque dans les gestes. Le film poursuit le travail de mise en scène de Jamsran dans Le garçon et se distingue notamment par une réalisation dynamique avec ses travellings avant motorisés qui foncent au milieu du bétail et des passages poétiques ou oniriques étonnants : une poursuite vue du point de vue du papillon, cette tendance de Gombojav à incruster dans le plan plein de petites étoiles un effet qu’on retrouvera dans un flashback du Tamir limpide…). Indéniablement, un grand cinéaste est né. Si on y ajoute les images fascinantes de Sumkhuu Badrakh pour Sound of engine (1975), on tient là une micro nouvelle-vague mongole où se fait sentir l’influence des Kalatozov ou des débuts de Tarkovski.
Mais un autre trait caractéristique de cette génération des années 60, moins facile à appréhender sans en connaître les auteurs mongols, ce sont les nombreuses adaptations d’oeuvres littéraires comme La fille rejetée (1961, D .Tchimid-Osor) d’après T. Damdinsuren.
Les sous-thèmes sont déjà bien en place : on peut même parler de sous-genres tournant autour de personnages archétypaux : film de tracteur (quoique moins répandus qu’en URSS!), film centrés autour de jeunes bergers. La place de la femme est mise en avant, notamment dans la comédie de Dorjpalam, Ces filles. Un vœu pieu du socialisme qui est parfois bien loin de réalités sociales beaucoup plus patriarcales.
Innovation formelle importante, le surgissement de la couleur dans le cinéma mongol. En 1961, le premier film en couleur Le palais d’or coproduit avec la DEFA est allemande mais réalisé par Ravjaaguyn Dorjpalam, était adapté d’un conte du folklore mongol. Il comporte une partie féérique avec ses quartz géants et de délicieuses séquences « sous-marines » tournées dans les tudios de Babelsberg. Pour autant et même si la transposition de l’ionographie mongole dans le fantastique est intéressante au plan des superbes décors, c’est dans les scènes simples (un cavalier au galop mettant pied à terre devant la yourte), les paysages idyllique dignes du Shane de George Stevens, la direction burlesque des acteurs ou des effets fantastiques simples mais mieux amenés (un cheval sans cavalier fend un troupeau de moutons) que Dorjpalam tire le mieux son épingle du jeu dans cette superproduction dont on peut imaginer l’impact durable sur le public local. Quant au Cinémascope, il arrivera avec La légende de mère Oasis (Gombojav, 1976).
Tourné pour le 50ème anniversaire de la Révolution et œuvre maîtresse du genre historique, Le tamir limpide (1970) du même et inépuisable Rajvaaguyn Dorjpalam adapte le roman du révolutionnaire Chadraabalyn Lodoidanba et regroupe au long des 4h25 de ces trois parties, une grande partie de la profession. Le meilleur épisode est le premier, c’est à dire la période prérévolutionnaire qui nous montre différents personnages appartenant, soient au peuple, soient à la noblesse ou au clergé. Là encore, ces personnages sont des archétypes et des figures célèbres de la période. Difficile à suivre par sa choralité et ses longues parties dialoguées, le film est remarquable par le classicisme de sa mise en scène, toujours dans ses rapports d’échelle ou entre la yourte et l’infini du dehors. Autant de majesté et d’ampleur jusque dans les détails du quotidien nous évoquent le cinéma de Ford (son côté eastern affirmé). Pour autant, les historiens du cinéma mongol épingle un peu sa « reconstitution » et un penchant pour l’exagération qu’il est bien difficile d’évaluer. Après un ventre mou dans le second épisode, entièrement dévolu à la guerre civile contre les troupes d’Ungern notamment, le dernier épisode finit en beauté et clarifie les parties opposées (notamment la résistance des religieux). Pour le moins bon, cette représentation naïve du grand frère russe bienveillant. Mais le film comporte aussi de beaux moments de vie dans la yourte (scène des osselets), parfois magnifiés par des 360 impressionnants de clarté. Autre détail entre le début et la fin du tournage, trois ans se sont écoulés et le zoom optique s’est aussi imposé en Mongolie. Il reviendra souvent par la suite, par exemple chez Gombojav.
Comme partout ailleurs dans le monde, on redécouvre les communautés rurales oubliées et les milieux hostiles. C’est le cas de Rajvaaguyn Dorjpalam avec Mirage sur le désert de Gobi (1980), qui succède à un Sound of engine situé dans l’extrême sud de ce désert réputé hostile.
La décennie 70 se clôt sur le très beau biopic du peintre Sharav dans Les cinq couleurs de l’arc en ciel (1978) de Nagnaidorj Badamsuren. Le travail sépia sur la jeunesse du peintre et son passé de moine bouddhiste dédié aux sujets religieux comme l’enthousiasme révolutionnaire et coloré final retracent au plus près une époque. Le film évoque la naissance des arts (photographie, cinématographe) qui vont accompagner les soubresaiuts politiques et sociaux. Excellent cinéaste, Nagnaidorj colle au plus près de ses protagonistes et sait rendre cette histoire beaucoup plus vivante que figée sur la toile. Encore un film mongol qui mériterait de se hisser au niveau des classiques du cinéma mondial ! Parmi ses autres réalisations, citons le curieux Mission de combat (1985) qui propose un tableau idyllique du front russo-mongol à la bataille de Khalkhin Gol. Cet incident frontalier de 1939 eut lieu en Mongolie entre armées soviéto-mongoles et nippo-mandchoues, une bataille pour une zone dunaire de pâturage autour de la rivière Halha, un site qui a toujours vu les clans locaux s’affronter pour son contrôle. En prélude à la seconde guerre mondiale, l’affaire a quand même fait 19000 morts et considérablement affecté la cavalerie mongole. Ici il s’agit d‘une jeune fille déguisée en garçon qui part sur le front à la recherche de son père. Dans une ambiance entre drôle de guerre et colonie de vacances, le film est marqué par la réalisation de Badamsuren qui met en scène des épisodes étranges sous une lumière très crue, voire saturée (début des bombardements ou encore l’excellente séquence du parachutiste japonais). L’onirisme sous-jacent permet un peu de mise à distance vis à vis de la réalité historique quand la caméra prend les lieux à bras le corps (voir sa manière de cadrer une tranchée).
Le bilan numéraire des studios Mongol kino est important. Il est aussi passionnant de voir l’évolution technique, stylistique ou thématique d’œuvre en œuvre. Qualitativement, un certain nombre de sujets trop pédagogiques et à la morale édifiante sont victimes des bons sentiments (Par l’appel de l’esprit, 1965, toujours de Dorjpalam) et du nivellement idéologique.
Au plan économique mais aussi thématique et culturel, la rupture se produira en 1986 avec le relâchement politique et l’arrivée de L’aigle fier le lutteur de Jamyanguyn Buntar, film très maîtrisé qui rompt autant par la production que par son sujet avec le cinéma officiel. Le film réaffirme la puissance des traditions (ici la lutte) et remet à l’honneur le nom de Genghis Khan. C’est dans l’exactitude de sa peinture historique et son respect des traditions que le film s’écarte de ses prédécesseurs. Par ailleurs le filmage très près du corps rend les scènes martiales formidables, Buntar élevant ce sport au rang d’art. Sens des paysages et du montage font aussi du film le plus bel hommage à la lutte (avec Foxcatcher) de tout le cinéma mondial. Enfin, le romantisme bientôt échevelée du couple principal prolonge le plaisir immense pris depuis le début à ce récit initiatique.Le cinéaste n’oublie pas pour autant de brocarder la noblesse ou l’hypocrisie du clergé. Il s’agit pour son héros de revenir à certaines valeurs pour s’élever en tant qu’humain et écrire son propre destin. Après 1992 et la coproduction de Baljininnyam avec le Japon, Genghis Khan redeviendra ce grand héros national érigé en mythe. Mais sa plus belle fresque épique reste son opera magna sur l’impératrice du 15ème siècle, Mandukhaï (1987), bien mongole celle-là et réalisée après son huis-clos étouffant L’ombre (1986) sur fond de traumatisme, lui aussi lié à la bataille de Khalkhin Gol.
A noter parmi les films en costume, le très curieux Golden falcon (1989) de Jigjidsuren Gombojav. Les Niruns doivent y affronter les Moohoi qui ont dérobé leur idole, le faucon d’or. Entre le mythologique et l’historique ce film épique comportant à la fois de très beaux moments d’action mais aussi des scènes parlées très calmes, montre un auteur qui trace sa voie vers le modernisme : les échelles de plan y sont peu conventionnelles et alliées à un sens plastique rare et à un travail de la couleur original (ici un peu gâché par un négatif virant au rouge). Voici un film qui n’a rien à envier aux grands cinéastes japonais. Une sorte de fable qui préfigure l’envol de sa carrière après la fin du communisme.
La Perestroika, puis la fin de la période socialiste, sont comme partout ailleurs l’occasion de la floraison de nouveaux thèmes. La culture jeune s’impose et notamment les groupes de rock comme dans I love you (1985), sorte de teen movie générationnel quoi que platement réalisé, mais surtout avec l’incroyable Ronds dans l’eau (1989) (ou Spirale ou encore Vortex pour le titre anglais !) film rock, le plus souvent nocturne et urbain qui semble répondre à L’aiguille de la nouvelle vague kazakhe en beaucoup plus désespéré. Acteur et scénariste, Chyombolis Jumdaan marque un grand coup pour ce second long-métrage, autant par son esthétique (tournage en 16 mm, images très sombres et contrastes poussés par le grand chef opérateur Delger Battulga) qui va faire passer le destin de cette histoire d’amour entre un beatnik et chanteur de hard rock et unee jeune fille de la campagne venue chanter à la ville, du romantisme à la tragédie nihiliste. Incapable de défier les lois de son clan, le héros fera payer à celle qu’il aime le prix de sa lâcheté. Le film dénonce les violences faites aux femmes et tranche radicalement avec les figures féminines en vogue. Jumdaan ne se trompe pas puisque depuis l’invasion capitaliste, les évolutions de la société mongole ne font que renforcer des structures archaïques et les schémas de domination. Contemporain de la vague existentielle en URSS, Ronds dans l’eau lui est supérieur par sa sécheresse de ton, son lyrisme et sa sincérité. L’isolement du pays va souder autour de Jumdaan un groupe de jeunes auteurs indépendants dont il sera la tête chercheuse et qui réclameront un retour aux valeurs traditionnelles. Il n’est pas étonnant que ces situations borderline nées d’une urbanisation sauvage et corollaire de l’exode rural, aient séduit les occidentaux en quête des signes de l’implosion du bloc communiste. Ils coproduiront dans un contexte semblable un plus propre Aldas (1994) sur là tentation occidentale et cette fois, à la diffusion internationale.
Vortex (1989)
Côté urbain encore, il faut souligner le beau film néo-réaliste, La corde (1991) de la réalisatrice Uranchimeg Nansal (et la très belle photo moderne de J. Binder après un début quasi expressionniste), passée à la réalisation en 1987 pour Avant la fin du conte, bien que souvent dépossédée de sa fonction de réalisatrice dans les notices de films. Elle n’hésite pas à tirer sur la corde sensible et à user de ce symbole (la chaîne des tous petits à laquelle se raccroche un moment le jeune héros) pour tisser sa parabole. Triste, désabusé et même cruel, le film évacue la dimension spectaculaire (les dangers de descendre les immeubles à la corde pour aller cambrioler les appartements dans les tours) pour coller à la bouille de son gamin des rues dans la grande tradition de De Sica. Détail amusant, le look très mastroiannien du cambrioleur meurtrier bien que totalemnt dénué d’humanité. Un autre beau film crépusculaire de cette fin de règne. Cette première œuvre tranche avec Heaven’s animals (1994) qui s’échappe vite vers la ruralité. Un film familial mais qui contient quelques séquences plus amples avec les troupeaux de chevaux. Parmi les autres cinéastes importants, le fils de Jigjid, J. Binder, excellent opérateur, s’avère lui aussi un cinéaste intéressant (Les liens du sang, 1993).
C’est aussi dans ce contexte crépusculaire que Jigjidsuren Gombojav choisit de réaliser sa trilogie informelle Au bord de la mort qui restera le gros morceau emblématique de cette transition à la fois historique, politique, culturelle et esthétique. En cela, le cinéaste suit l’évolution de la société toute entière : libération de la parole avec le devoir de mémoire envers les crimes de Choibalsan (Larmes de la stèle, 1991), fable post apocalyptique hantée par la disparition du reste du monde (Ruines tièdes, 1991), contemporaine de cette prise de conscience que la libéralisation des marchés ne fait pas forcément une place à la Mongolie sur la carte du monde. Ici les symboles priment et Gombojav atteint un naturalisme deleuzien pour dénoncer l’iniquité d’une cellule familiale incestueuse et suicider une société traditonnelle repliée sur elle-même. La force incantatoire de cette prière, de ce chant poétique fortement érotisé (on songe au Tsui Hark de Green smake qui aurait rejoint l’ambiance funeste du Onimaru de Yoshida) tente de conjurer la possible disparition des artistes mongols. Le film le plus original du cinéma mongol et qui plus est, une œuvre qui lorgne vers le genre (une obsession constante si on songe au pitch du Faucon doré) . Troisième pierre de touche de ce temple : Traces d’une existence (1992), un choc psychologique et esthétique où la mise en scène de l’auteur atteint son apogée, tant pour sa gestion de l’espace que dans son art du portrait portant son découpage à incandescence. La quasi absence de dialogue pour relater la vie misérable d’un enfant muet, né du viol d’une jeune femme envoyée de force à la campagne par un technicien agricole citadin ivre, renforce sa puissance dramatique et notre immersion dans cette fable rurale dont la yourte est le centre. La critique politique ne se dissimule plus derrière la métaphore mais aborde frontalement l’histoire récente, ici le mouvement « Ilgeeltiin ezen », une sorte de révolution culturelle mongole initiée par le président Tsedenbal Yumjaa à la fin de la décennie 70, visant à déplacer des populations urbaines à la campagne pour leur édification. Gombojav transcende de nombreux thèmes comme le rapport assez unique à l’animal (qui ne se retrouve guère que chez d’autres cultures agro-pastorales nomades mais généralement assez peu avancées sur le plan cinématographique), l’animalité de l’homme- car ici son usage pulsionnel du zoom met en valeur l’inhumanité du beau-père-, le lien filial. Point commun avec l’œuvre précédente comme avec la période : la faim, de nourritures terrestres, d’amour ou de reconnaissance. La portée allégorique d’un épilogue évacuant tout réalisme au profit d’un dénuement édenique (ce dévoilement du corps est constant dans l’ensemble de l’oeuvre du cinéaste, comme un prélude à toute renaissance) est un véritable appel à la jeunesse à se révolter contre les vielles structures archaïques et patriarcales pour partir à la découverte du monde. Toujours intéressant, l’auteur ne semble pas avoir retrouvé cette puissance dans les œuvres ultérieures. Même s’il déplorait la piètre qualité du cinéma mongol contemporain lors de sa venue eu FICA, il semble dans un premier temps avoir eu quelque influence sur certains autres réalisateur, par exemple sur le film Running antelope (Nyamgavaa et Nyamdavaa, 1993), auteurs par ailleurs de plusieurs beaux films des années 70 et 80 : Fiez vous au berger en 1979 a une manière particulière de filmer les montagnes, frontale et carrée, tout en racontant de manière simple la vie d’un jeune berger du rant la période pré révolutionnaire avec sa noblesse et ses lamas autoritaires et égoïstes).
Dans la catégorie cinéma d’auteur post Perestroïka, mentionnons le passage du belge Peter Brosens dans la région pour sa trilogie mongole, au moins pour cette collaboration de avec Dorjkhandyn Turmunkh qui semble avoir ici joué un rôle important dans la réussite de ce splendide essai qui joue entre, fable contée, observation documentaire, fiction du réel ou expérimental contemplatif. Créditons toutefois Brosens de l’idée de nous raconter l’histoire de la transition en Mongolie à travers le regard chaleureux… d’un chien mort ! Etats de chiens (1998) est un splendide voyage qui nous perd ailleurs pour notre plus grand bonheur.
Mongol kino ferme ses porte. C’est le chômage pour tous les techniciens et cinéastes du studio. La fin du régime signifie aussi celle de tout contrôle et de toute censure politique, ce qui stimule d’abord la production (42 films tournés en 1993). Des années 80 à 1994, le cinéma mongol se sera donc épanoui et aura rayonné vers de nouvelles directions.
Hélas, son studio colossal mais aussi dépassé technologiquement, n’a pas fait de petits en Mongolie. De 1992 à 1997, apparaissent une vingtaine de boites de production indépendantes, vite endettées. Il y en aura bien plus encore par la suite et on tourne en moyenne 50 longs-métrages par an. Des salons vidéos fleurissent un peu partout et dépassent vite les quelques 27 salles réparties dans tout le pays. Mais liberté et prolixité masquent un effondrement presque intégral de sa distribution nationale et d’une industrie cinématographique fragile sur la scène internationale. Cette problématique demeure hélas aujourd’hui avec comme ailleurs le règne des multiplexes. La production nationale se réfugie sur le marché du dvd puis de la vod, avec des budgets à l’avenant. Pire, la formation et l’éduction à l’image sont presque inexistantes et orientées pour la télévision. Il faut donc attendre que depuis les séries, la publicité ou le clip vidéo, de nouveaux talents s’affirment comme de vrais artistes.
Les rares films à voir émergé en Mongolie furent donc des coproductions avec l’Allemagne où réside Byambasuren Davaa, meilleure ambassadrice du cinéma mongol et qui dans les traces de Nansal, triomphe avec des films familiaux et semi-documentaires à nouveau situés en milieu rural (L’histoire du chameau qui pleure (2003) et cette scène de mise à bas magique, beaucoup moins Le chien jaune de Mongolie (2005), plus apprêté). Ces films démontrent que vraiment rien n’a changé dans la steppe et le processus de désertification des campagnes se poursuit (Oulanbatorisation). Dernier opus de la trilogie, Les deux chevaux de Genghis Khan est axé sur la musique avec dans le rôle principal l’excellente chanteuse Urna Chahar-Tugchi,
Les deux chevaux de Genghis Khan (2009)
Du côté des productions nationales (nationalistes?), le film d’action se taille la part du lion jusqu’au marché asiatique, par exemple pour Trapped abroad (Janchivdorj Sengedorj, 2014) sur le trafic de la drogue depuis la Chine. Bien diffusé en Asie ou sur le web, ce film qui a tout raflé aux césars mongols, relève un peu le niveau, ne serait-ce que techniquement. Certaines plans nocturnes sont sublimes et témoignent du vrai sens visuel du cinéaste. La platitude minimaliste des dialogues en intérieur et la naïveté des flics mongols est contrebalancée par la brutalité des scènes d’action où le mano à mano est roi. On comprend alors pourquoi chinois, coréens et japonais sont si curieux du style mongol. Encore une fois, il faut le retrouver dans cette capacité à magnifier l’espace notamment dans deux scènes sur la glace dont le final âpre et bucolique. L’acteur Baljinnyamyn Amarasaikhan se taille la part du lion (jaune de Mongolie) dans ce film dont il est aussi producteur et impose sa stature carrée. Clin d’oeil ultime, l’arrivée d’un tracteur conduit par une vieille en guise de cavalerie (!), histoire d’annoncer une suite sans grand relief (2016, tournée par son producteur, Erdenebileg Ganbold). Un film honorable qui n’a pas reçu l’assentiment des festivals occidentaux préférant dans le genre un Opération Tatar (Bat-Ulzii Baatar, 2010). Par ailleurs et selon le témoigange de Bastian Meyresonne, en Mongolie, le film d’action à petit budget n’est pas un business de tout repos et la concurrence s’y règle vite par mort d’homme.
Le genre épique a quant à lui décliné le mythe de Genghis Khan de la cave au grenier, passant du paradigme chanbara nippon au Wu xia pian numérique chinois, ce représentant, lourdingue ou céleste selon les goûts, d’un nouvel ordre mondial.
Avec leur budgets dix ou trente fois moindres, les productions mongoles peinent un peu au niveau des CGI comme en témoignent dans la séquence d’introduction de La légende de Gobi (Davaajargal Tserenchimed, 2018) ses troupeaux d’antilopes et plus loin ses fortifications fantômes. Mais en travaillant les couleurs à la chinoise, le cinéaste donne à ces visages héroïques comme à toutes les scènes d’intérieur une vraie majesté et quelques fulgurances qui souffrent parfois d’un montage trop syncopé. Les paysages sont réduits au maximum pour rompre avec l’ancienne époque, à moins que ce ne soit pour ne pas faire d’ombre au catalogue d’extérieurs déployés sans relâche côté chinois. Découpés et aplatis à grands coups de drônes, ils sont en plus saucissonnés par un montage qui n’a semble-til retenu aucune leçon des maîtres du patrimoine national. Pourtant, malgré tout et bien que le thème du massacre des musiciens n’ait pas été si bien exploité que cela aurait du, le film se regarde plaisamment. Il nous marque notamment pour certaines scènes, notamment cet enlèvement de la princesse durant un spectacle de ce théâtre d’ombres hérité de l’occupation mandchoue. Parmi les autres réussites du genre, signalons également Musq (2016) d’Erdenetsetseg Bazaragchaa ou plus diffusé, The Last Princess of Royal Blood: Tsetsenhangru (2008) du célèbre comédien Bayaneruul (Mongol) dont le sens de l’image pour les mêmes moyens est bien plus probant que celui de son collègue Enkhtaivan Agvaantseren qui la même année, réalise sur un thème très intéressant, l’extermination des bouriates durant les années 30, le trop minimalisteet timide La perle de la forêt.
Côté épopées guerrirères plus récentes, The war lord (marked man) de Delgerbayar Purevdorj rend hommage à la cavalerie mongole par une reconstitution très spectaculaire de la bataille de Khalkhiin Gol. Il semble que du côté de Mongol films, on mettre les bouchées doubles pour donner des moyens et relever le niveau (voir les pathétiques courts-métrages sur leur chaîne you tube pour mesurer cette impressionnnante progression).
Bien d’autres œuvres dont ainsi directement plébiscitées par le public mondial via internet ou sur Netflix, notamment Golden Treasure (2016) d’Uranchimeg Nansal qui adapte le cadre de Heaven’s animals à la photographie du jour plus commerciale, un peu handicapé par une bande originale tonitruante mais qui mériterait d’être diffusé chez nous ou encore The steed (2019) du même Erdenebileg Ganbold, dignes représentants d’un néo cinéma mongol (trop) léché, de même que Les enfants de Genghis (Dorj Zolbayar, 2017). Evoquons aussi le très mélodramatique White blessing ( Janchivdorj Sengedorj, 2017, à qui l’on doit aussi Voleur d’esprit (2011)) qui a l’avantage de développer des thèmes contemporains (l’héroïne est une judoka) et confirme l’importance de la place désormais attribuée aux personnages féminins sous la pression d’une vague mondiale.
Quelques films d’auteurs émergent de la médiocrité de l’ensemble. Ainsi Byamba Sakhya, qui avait réalisé le documentaire Passion ( 2010) sur l’état du cinéma mongol (mais aussi participé au Poètes de Mongolie avec Peter Brosens et Peter Krüger) a signé la fiction Remote control (2013) à la mise en scène de qualité pour une production assurée depuis l’étranger. Elle aurait du être en compétition à Nantes au dernier festival des 3 continents avec son Bedridden (2020) tourné en noir et blanc. Ce n’est que partie remise…
Remote control de Byamba Sakhya (2013)
Enfin, Remember me (Gan-ochir Enebish, 2021) n’est pas totalement abouti mais peut se targuer de plusieurs sélections dans les festivals internationaux grâce à son sujet original : l’élimination de milliers de livres lors de la transition vers la démocratie, lorsqu’on a proposé de recycler tout le métal et le papier et incité les gens à les remettre contre de l’argent. Cette romance de teenagers bénéficie là de quelques plans spectaculaires.
Ce même réalisateur distribué par la firme ayant pignon sur rue aux Etas-Unis, Mongol films sort en 2021 le documentaire Solongo où il suit l’entrée à l’école d’une fillette de six ans.
En dépit d’un historique chargé, le documentaire mongol nous est peu accessible. Relevons au moins le nom de l’opérateur, cinéaste et alpiniste (!) Zanabazar de Radnaabazar entré en 1980, au Studio du Film Documentaire. On lui attribue au moins 25 films. Seul trace de son travail, un court sur des bouddhas mniatures aux postures tantriques, dans un classicisme et un commentaire didactique qui évoque les films d’art de Paradjanov en Ukraine au tout début des années 60.
Si la production locale patine faute de budgets décents, d’aides publiques, de structures professionnelles, les cinéastes eux ne manquent pas d’ambitions. Le pays a aussi vite été colonisé par des réalisateurs ou organisateurs étrangers. Les festivals y fleurissent et auront au moins le mérite d’avoir révélé dans des domaines plus étonnants quelques jeunes artistes mongols comme Zulaa Urchuud dans le champs expérimental. On lui doit d’abord des travaux graphiques très colorés (Mayfly, sur l’éphémère vie d’un insecte : impermanence des choses mais sensations permanentes), dont la forme circulaire évoque parfois la yourte et la cosmologie mongole (If spectra ou plus minimaliste, Black en 2017), mais aussi de nombreux films plus abstraits et contemporains, presque inquiétants (Blue). Un nouveau regard sur son environnement comme le montre Inherent instinct (2013). Dernièrement, la réalisatrice s’attache à revisiter la mémoire audiovisuelle avec plus ou moins de bonheur (le très beau Urgoo qui mélange à la fois classique socialiste et images documentaires d’un lieu de culte d’aujourd’hui). Elle s’est même essayée au remake minimaliste de Twin Peaks (Untwined peaks, 2017) ! Elle réalise de nombreuses installations, fonds d’écran ou films en réalité virtuelle En 2019, Zahia (a letter) est présenté au festival de Locarno et confirme son attrait pour le film de montage. Sélectionné en 2021, Ulaanbaatarization est présenté en ligne : la vie urbaine y recouvre progressivement les images de la vie pastorale et nomade du passé.
Après un long hiver néolibéral, le cinéma mongol se remet tout doucement en selle. Il a réussi à recréer une industrie, scrutée de près sur le marché asiatique et à mettre en avant plusieurs auteurs qui percent dans les festivals cette année. Zoljargal Purevdas (dite Zoro), formée au Japon et ayant tourné des courts en Australie ou Lkhagvadulam Purev-Ochir font partie de cette nouvelle génération qui passe à la réalisation et rentre au pays et que Gombojav appelait de ses vœux, tout en constatant une lente mais notable amélioration des films. Si l’on songe à l’odyssée du kazakh Bekmambetov, devenu le patron du cinéma d’action russe contemporain avant que de rénover de l’intérieur le cinéma d’action numérique d’Hollywood, on se dit que le cinéma de Mongolie cache peut-être de belles cartes à jouer qui lui permettraient de reconquérir le monde.
Sources : Bastian Meyresonne, catalogue du FICA de Vesoul 2018, Premendra Mazumber dans Dictionnaire du cinéma asiatique (nouveau monde éditions), Dashtseren Tsolmon dans Ctalogue du 19ème festival des 3 continents, Une histoire du ciném mongol (Films de l’Atalante), www.mongolkino.org, www.mongolkino.mn.
Un grand merci à Bastian Meyresonne pour sa science et sa disponibilité !